Entretien (1ère partie) : Retour
sur le Journal
Fabrice Neaud a déjà
répondu à de nombreuses questions dans le cadre de
plusieurs entretiens. Je ne peux que conseiller ici la lecture de
deux d’entre eux en particulier : celui de Bdselection, disponible
en ligne ici, et celui inclus dans l’ouvrage dirigé
par Thierry Groensteen, 'Artistes de bande dessinée'.
Pour compléter ces entretiens et faire un
point plus récent, j'ai longuement interrogé Fabrice
Neaud sur des sujets variés durant l'automne 2006.
L'entretien qui en résulte est mis en ligne ici, en plusieurs
parties. La première d'entre elle cherche à faire
un point sur l'activité de Fabrice Neaud
pendant les dernières années.
Sébastien Soleille : Vous avez souvent
été mécontent de la réception faite
à vos livres, des interprétations et des lectures
qui en ont été faites : plusieurs anecdotes du volume
4, notamment, en témoignent... Pensez-vous que de nombreux
lecteurs et journalistes vous comprennent mal ? Si oui, à
quoi attribuez-vous cela ? Les choses ont-elles évolué
au fil du temps ?
Fabrice Neaud : Ceci
est une très délicate question. Je vais tâcher
d’y répondre en plusieurs points. Tout d’abord
concernant les anecdotes relevées dans le tome
4… Il ne faut pas oublier que celui-ci, publié en
2002, fait le récit d’événements datant
de… 1996. Par conséquent, ces événements
recouvrent principalement, pour la partie que vous abordez, la publication
du premier tome du Journal. La réception de
mon travail à ce moment-là n’a que peu de chose
à voir avec sa réception ultérieure, même
si je reste assez mécontent, dans l’ensemble, de cette
dernière. La réception du tome
1 est essentiellement liée à celle d’un premier
livre et je pense que les échos du moment reflètent
davantage la structure de réception d’un premier livre,
quel qu’il peut être, que celle, plus précise,
du mien.
 La scène avec l’animateur de radio, par exemple, fait
le portrait d'une radio très locale, avec les défauts
de l’amateurisme de celle-ci et de l'inexpérience de
l’animateur en question. Si l'on y regarde bien, on peut noter
que c’est une vraie caricature d’interview provinciale
(ce qu’elle fut). L’animateur n’a pas même
vingt ans, il a une veste qui le déborde de toute part et
ses questions sont d’une stupidité affligeante, sur
un travail qui, à bien des égards, le déborde
également de toute part. Il ramena tout à des spécifications
provinciales, dans le sens le plus péjoratifs du terme.
La scène avec l’animateur de radio, par exemple, fait
le portrait d'une radio très locale, avec les défauts
de l’amateurisme de celle-ci et de l'inexpérience de
l’animateur en question. Si l'on y regarde bien, on peut noter
que c’est une vraie caricature d’interview provinciale
(ce qu’elle fut). L’animateur n’a pas même
vingt ans, il a une veste qui le déborde de toute part et
ses questions sont d’une stupidité affligeante, sur
un travail qui, à bien des égards, le déborde
également de toute part. Il ramena tout à des spécifications
provinciales, dans le sens le plus péjoratifs du terme.
Concernant la rencontre dans le « salon de
lecture », je fais là aussi un autre type de portrait
: portrait d’une aventure encore plus locale qui plus est organisée
par un ami qui pensait bien faire et n’imaginait pas une seule
seconde que ça allait se passer aussi mal (il était
très gêné à la fin… Je crois même
qu’il a quitté le salon de lecture en question peu de
temps après). Dans cette scène, ce qui m’importait
c’était aussi de dénoncer une situation morale
: comment répondre aux attaques faites par l’hôte
qui nous a invité dans son salon ? Je n’ai fait là
que la peinture d’une situation que l’on retrouve aussi
à d’autres échelles et qui peut aussi refléter
des questions de pouvoir… Dans cette scène, je voulais
montrer que la “lecture” de mon travail, du seul fait
qu’elle s’effectuait chez cet hôte, lui autorisait
à asseoir son pouvoir sur autrui (les autres associés
du salon) et sur moi-même. Cette situation m’interdisait
de réagir à ses critiques et lui permettait, à
lui, d’étaler sa propre fatuité et son narcissisme.
J’avais juste été pris en otage d’un petit
chef, « prof » de son état, et qui m’avait
instrumentalisé juste pour se mettre en valeur. Même
si ces deux scènes relataient déjà mes premières
relations à la « critique », elles n’avaient
pas l’ambition de faire un bilan global de celle-ci, bilan
que je peux davantage faire aujourd’hui… Et ce à
quoi m’autorise notre entretien, plus que bienvenu.
Si l’espace nous le permet, je pourrais m’amuser
à vous faire un panoramique des diverses lectures de mon
travail dont je peux aujourd’hui proposer une petite synthèse,
citations à l'appui. Ce serait très drôle et
très instructif...

Pensez-vous que l’on puisse juger vos livres
comme des ouvrages de fiction? En d’autres termes, dans quelle
mesure pensez-vous que la prise en compte de la dimension autobiographique
soit nécessaire au lecteur pour apprécier votre œuvre?
C’est vraiment très difficile de répondre
à ce type de questions. La question que vous posez est bien
celle de la tribune… D’où parle-t-on ? Qui parle
? Mais aussi : qui lit ? Qui reçoit ?
J’ai pour habitude, désormais, de conseiller
– bien que cela reste des conseils purement académiques
– que les gens réellement « concernés »
par mon travail devraient prendre une grande inspiration avant de
me lire et tâcher de s’imaginer que c’est une fiction.
À l’inverse, j’aurais plutôt tendance à
conseiller aux autres (la grande majorité, j’espère)
de ne pas oublier la dimension autobiographique. Mais il faudrait
redéfinir ce que veut dire « autobiographique »
aujourd’hui, tant cet adjectif et le substantif qui lui est
lié veulent dire tout est leur contraire.
Pour moi, « autobiographique » veut
dire « incarné », « non académique
», « habité », davantage que seulement
« racontant la vie du narrateur », ce qui reste exact
aussi. Le problème, c’est que l’adjectif «
autobiographique » veut souvent dire pour bien des lecteurs
et, se faisant, des critiques, « racontant la vie du narrateur
d’un point de vue strictement subjectif ». Hélas,
par « subjectif », on entend souvent nécessairement
parcellaire, partiel, donc partial et, par voie de conséquence
ultime : faux. Si je résume, nous avons donc comme
grille de lecture préalable : « toute autobiographie
est fausse et tout ce qu’elle raconte ne peut être qu’un
reflet faussé de faits réels, voire supposés.
» Cette grille de lecture part d’une distorsion psychologisante
du dit autobiographique. Si toute autobiographie raconte la «
vie du narrateur d’un point de vue strictement subjectif »,
il est alors évident que le prima du psychologique
domine, avec toutes les incapacités préjugées
péjoratives de produire une parole sensée, juste,
dégagée de la subjectivité ou seulement s’élevant
un peu au-dessus d’elle. Il est tragique de constater combien
ce pauvre mot emprisonne qui l’émet dans une nasse sémantique
aussi réductrice. La grille psychologisante, qui est devenue
aujourd’hui le signifié ultime extrait aux forceps par
qui pense l’autobiographie comme ça, amène fatalement
à la ranger, elle et ses auteurs, dans les catégories
cadenassées de la psychiatrie, carrément. Fatalement,
faire de l’autobiographie signifie avant toute chose pour bien
des gens être « nombriliste », « égocentrique
», « égotiste », « narcissique »
et par là même « inintéressant »
puisque faux… Rangé dans les couloirs d’un asile
d’aliénés esthétiques, tout diariste ou
autobiographe peut être jugé, en dernière instance,
comme un taré pour qui l’œuvre n’est plus
rien qu’une thérapie. Il est évident que seront
considérés comme des tarés eux-mêmes
ceux qui s’intéressent à ce genre de productions
ou alors, au mieux, comme des victimes d’un créateur
ayant réussi à les entraîner dans son délire
par un système aliénant relevant du harcèlement
moral…
Il est évident qu’avec une telle définition
préalable, de tels présupposés, on peut difficilement
apprécier une œuvre autobiographique à
sa juste mesure.
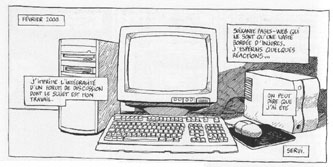 Ce délire mien produit à l’instant autour de
la perception supposée par beaucoup de toute production autobiographique
ne pourra se ranger – bien évidemment – que dans
les mêmes tiroirs de l’aliénation mentale par
les mêmes contempteurs d’icelle… Cette lecture préalable
est donc imparable. À titre d’illustration, les critiques
d’un Thierry Smolderen faites en
leurs temps sur F.rec.arts.bd sont un exemple de lecture psychiatrisante
de mon travail parfaitement éclairante et totalement indéboulonnable…
Mais cela n’étonnera guère venant de la part
d’un ancien ponte déchu de la critique BD recyclé
« prof » et qui poussait le vice jusqu’à
se faire appeler Doc (comme celui de Fun radio) par
ses sujets.
Ce délire mien produit à l’instant autour de
la perception supposée par beaucoup de toute production autobiographique
ne pourra se ranger – bien évidemment – que dans
les mêmes tiroirs de l’aliénation mentale par
les mêmes contempteurs d’icelle… Cette lecture préalable
est donc imparable. À titre d’illustration, les critiques
d’un Thierry Smolderen faites en
leurs temps sur F.rec.arts.bd sont un exemple de lecture psychiatrisante
de mon travail parfaitement éclairante et totalement indéboulonnable…
Mais cela n’étonnera guère venant de la part
d’un ancien ponte déchu de la critique BD recyclé
« prof » et qui poussait le vice jusqu’à
se faire appeler Doc (comme celui de Fun radio) par
ses sujets.
Bref, pour revenir à votre question –
car je m’en suis fort éloigné pour donner du
grain à moudre aux docteurs qui m’ont depuis longtemps
condamné à la camisole intellectuelle – je dirai
qu’après avoir bien fait un minimum de travail sémantique
sur ce que pouvait être l’autobiographie ou la fiction
j’osais imaginer qu’une lecture de mes livres peut aussi
s’envisager sous un angle politique plus que psychologique.
C’est tout. Rien à voir avec les catégories formelles
de la fiction ou de l’autobiographie, pour le coup, car personne
ne sait plus même ce que ça veut dire depuis longtemps.
« Comme des ouvrages de fiction » n’a
donc pas vraiment de sens, en fait. Ce qui est certain, c’est
qu’il n’y aucune différence, mais alors aucune,
entre la construction et le travail sur une matière diégétique
qu’elle soit fictionnelle ou autobiographique. Devant la page,
devant le découpage, face au dessin, face à l’architecture
du livre et du récit, il n’y a rigoureusement aucune
différence entre le traitement à apporter entre
celle-ci ou celle-là. La seule différence à
mes yeux ne se situe pas sur le livre ou l’œuvre mais
bien sur les personnes concernées, auteur compris.
Je me tue à le psalmodier sur tous les tons, d’ailleurs,
depuis le début même de mon travail. Je n’ai pas
changé d’avis sur la question, pas d’un iota…
mais peut-être cela fera-t-il de moi encore un taré
psycho-rigide, qui sait ?
Ceci étant, si je peux apporter un peu de
soleil sur cet horizon plombé par le néant critique
qui a vitrifié toute la pensée occidentale depuis
que les médias de masse existent, je dirai que je suis toujours
resté étonné par la grande pertinence des articles
ou des critiques anglo-saxons… Que ce soit l’analyse de
Murray Pratt, professeur à l’université
de Modern Language de Sydney (How to study heterocentrism)
ou celle écrite par Bart Beaty
dans le Comics journal de février 2002 : Fabrice
Neaud: Rewriting Our Standards, il est clair que
nous sommes là face à un tout autre niveau. Et ceci
est d’autant plus admirable que mon Journal n’a
même pas de traduction en anglais !… À croire
que non seulement nul n’est prophète en son pays mais
que les bienheureux eunuques des alcôves désirées
que sont nos journalistes francophones ont tellement le nez dans
le guidon des exigences de « rendu » de leurs petits
papiers à leurs petits torchons qu’ils l’ont aussi
dans le caca de leur complexe d’infériorité face
aux auteurs… J’arrête là. Car c’est
leur faire trop d’honneur. Un doigt levé bien haut devrait
suffire.

Vos livres ont fait l’objet de lectures
savantes à plusieurs reprises (notamment lors de séminaires
à Lyon et à l'université de Leicester). Quel
effet cela vous a-t-il fait ? Pensez-vous qu'elles étaient
pertinentes ?
Pertinentes, sans nul doute… Comme quoi il
faut bien attendre une étude pointue et universitaire d’un
travail pour se dégager des présupposés de
lecture de la critique journalistique de base. En même temps,
c’est très triste. Cela voudrait-il dire que je ne suis
pas « accessible au public » mais seulement par des
universitaires ? Je ne le pense pas et je n’ai jamais eu l’ambition
élitiste de n’être lu et compris que par eux…
Cela serait sans compter le retour de certains lecteurs qui est
tout aussi pertinent, parfois, que celui de ces colloques et autres
séminaires… Sans compter qu’une lecture universitaire
reste elle aussi parcellaire. Sauf qu’à la différence
de la lecture journalistique frelatée qui esquinte à
peu près toutes les œuvres (je ne m’estime pas
en être la seule « victime », évidemment
– mais même l’emploi de ce mot me fait peur, désormais,
tellement je fus accusé par les psychiatres de PMU de m’enfermer
dans ce prétendu « rôle »…), la lecture
parcellaire des universitaires est consciente d’elle-même
en tant que telle, là où celle des plumitifs de la
presse prétend toujours être exhaustive et surplombante.
Que ce fut à Leicester en 2003, avec comme
collègues le très estimable Jean-Christophe
Menu et le non moins estimable Tanitoc,
ou à Lyon, grâce à Pierre-Yves
Carlot, auteur d’un mémoire étonnant intitulé
De l’ancrage référentiel… (dans mon
travail) que serait bien inspiré de lire les Smolderen
de la terre, si doctes à pontifier sur le « droit à
l’image » de certains de ces anciens poulains soi-disant
« profondément blessés » par mon travail,
la sérénité des débats, leur niveau,
furent un bol d’oxygène non négligeable dans
une atmosphère saturée par le CO2 à
effet de serre-tes-fesses de la critique ambiante…
Parallèlement, et abordant un panorama plus
global concernant la bande dessinée, il y a eu la récente
université d’été organisée par
le Cnbdi cet été 2006 et, là aussi, on planait
tout de même dans d’autres cieux plus respirables…
Bref, sans ces rares et excellents moments, il y aurait de quoi
se foutre une balle dans le crâne… Mais, rassurez-vous,
si cela devait se faire j’envisage quand même de trou-du-cuter
au famas quelques journaleux et autres « profs » stipendiés
avant de me faire sauter la carafe.

Vos œuvres sont souvent considérées,
notamment par certains de vos collègues, comme comptant parmi
les plus importantes des dix dernières années. Quel
effet cela vous fait-il ?
Ben… J’aimerais bien l’entendre
de vive voix un peu plus souvent… Mais si jamais ils me l’ont
dit et que je ne m’en souviens plus, la preuve est faite que
je suis un aliéné. Qu’on m’enferme !
Quels échos avez-vous de la réception de vos livres
dans les pays non francophones, que ce soit lors de vos participations
à des expositions et rencontres dans différents pays
(Japon, Russie…) ou dans les régions où vos œuvres
ont été partiellement traduites (Italie, Espagne)
?
 J’ai
très peu d’échos concernant l’unique pays
où mon travail est traduit pour l’heure (l’Espagne).
Je ne parle pas de l’Italie : l’expérience s’est
ensevelie sous les sables dès la parution du premier tome
du Journal… Voilà qui fut un excellent encouragement.
Encore une fois, je reste surtout épaté par la réception
anglo-saxonne, alors que je ne suis pas traduit en anglais, comme
je l’ai évoqué plus haut. Mais cette réception
n’a eu lieu que dans un milieu assez étroit, j’imagine,
ce qui relativise l’enthousiasme, fatalement… Quant au
Japon, je ne sais pas si je peux juger, puisque le seul travail
traduit là-bas fait partie du livre collectif Japon
chez Casterman, initiative de Frédéric
Boilet. Je sais que ce livre a été traduit
dans pas mal de langues et qu’il a reçu un très
bon accueil, relativement à la difficulté de faire
passer des collectifs… Mais, comme je l’ai dit, je ne
sais pas dans quelle mesure mon propre travail, qui n’est que
le 1/16e de l’ensemble (puisqu’il y a huit
auteurs francophones et huit japonais…) est apprécié
ou non dans l’ouvrage. Et cela reste, malgré tout, une
vingtaine de pages… J’ai
très peu d’échos concernant l’unique pays
où mon travail est traduit pour l’heure (l’Espagne).
Je ne parle pas de l’Italie : l’expérience s’est
ensevelie sous les sables dès la parution du premier tome
du Journal… Voilà qui fut un excellent encouragement.
Encore une fois, je reste surtout épaté par la réception
anglo-saxonne, alors que je ne suis pas traduit en anglais, comme
je l’ai évoqué plus haut. Mais cette réception
n’a eu lieu que dans un milieu assez étroit, j’imagine,
ce qui relativise l’enthousiasme, fatalement… Quant au
Japon, je ne sais pas si je peux juger, puisque le seul travail
traduit là-bas fait partie du livre collectif Japon
chez Casterman, initiative de Frédéric
Boilet. Je sais que ce livre a été traduit
dans pas mal de langues et qu’il a reçu un très
bon accueil, relativement à la difficulté de faire
passer des collectifs… Mais, comme je l’ai dit, je ne
sais pas dans quelle mesure mon propre travail, qui n’est que
le 1/16e de l’ensemble (puisqu’il y a huit
auteurs francophones et huit japonais…) est apprécié
ou non dans l’ouvrage. Et cela reste, malgré tout, une
vingtaine de pages…
Ce qui est certain, c’est que j’ai pas
mal voyagé à l’étranger. La tendance s’est
même accélérée ces dernières années
; j’en suis très heureux car j’adore les voyages.
Mais il ne faut pas voir dans ces diverses destinations la preuve
d’une réception massive de mon travail ruisselant en
cataractes dorées dans les cerveaux extasiés de bonheur
de millions de lecteurs… Les voyages à l’étranger
sont souvent le fruit de politiques assez institutionnelles…
Au mieux, cela prouve que je suis apprécié dans certaines
sphères du « pouvoir » culturel. Est-ce un bien
? Un mal ? Je n’en sais rien… Quoiqu’il en soit,
ça à le mérite de me sortir de mon trou et
de changer d’air ; c’est un privilège que je savoure
en tant que tel.

En 2005, vous avez publié plusieurs reportages
dans Beaux arts magazine. Comment est née cette rubrique
? Pourquoi s'est-elle arrêtée ? Qu'avez-vous retiré
de cette expérience ?
Je connaissais Fabrice Bousteau, le rédacteur
en chef, depuis qu’il avait écrit l’édito
de Beaux-Arts magazine sur le Journal
3 pour son numéro de janvier 2000. Cela reste, pour
l’heure, l’un des textes les plus élogieux sur
mon travail. Comme quoi tout n’est pas si noir. Cela reste
surtout le premier texte qui commençait un tant soit peu
à poser les véritables enjeux du Journal. Qu’il
en soit remercié pour cela. L’aventure entre Fabrice
Bousteau et moi est même un peu antérieure d’un
an… Cette antériorité a son sens, on le verra
par la suite. En effet, un an auparavant, jour pour jour, Beaux-Arts
magazine avait consacré un numéro spécial
à la bande dessinée, et pas des moindres, avec une
sélection d’auteurs et d’œuvres qui tiraient
largement vers le haut. Sauf que, sauf que… Bousteau avait
rédigé un édito resté tristement célèbre
dans les annales de la bande dessinée en commençant
par une phrase que je restitue de mémoire, imparfaitement
sans doute : « ce n’est pas parce que nous consacrons
un dossier à la bande dessinée que nous considérons
celle-ci comme un art… » ou quelque chose d’approchant.
J’avais fait une réponse carabinée
à cet édito qui vit le jour dans la défunte
revue L’indispensable quelques jours juste avant l’édito
premièrement évoqué sur mon travail. Fabrice
Bousteau m’invita à discuter de tout ça lors
d’un déjeuner à Paris. Il mit son mouchoir sur
cette réponse (il ne pouvait pas faire autrement : elle était
plutôt juste, je crois) et je mis le mien sur son édito
dénigrant la bande dessinée comme un art ; nous nous
retrouvâmes sur un terrain plus serein et il souhaita dès
le début m’intégrer d’une manière
ou d’une autre dans sa revue.
La formule fut trouvée, selon lui, mais
seulement quatre ans plus tard, fin 2004, après quelques
apparitions irrégulières à Beaux-Arts
de ma part. L’ineffable Vincent Bernière servit quelque
peu de lien, parfois, mais la relation boustaldo-néaldienne
se fit largement sans son concours (et même malgré
lui, comme nous le verrons aussi par la suite). En décembre
2004, après avoir réalisé quatre pages en un
temps record sur le grand restaurant Lucas Carton et son chef Alain
Senderens pour un numéro spécial, Bousteau me proposa
un « Pacs », comme il l’appela lui-même,
en m’invitant à réaliser une rubrique régulière,
mensuelle, de trois pages en bande dessinée sur un sujet
de mon choix en rapport avec le milieu de l’art. Je ne sais
pas ce qui me prit à ce moment-là : une sorte de doute,
de prudence préalable ou de délirante paranoïa
(il paraît que je suis atteint de ce mal selon mes détracteurs
spécialistes ès-psychiatrie), mais je demandai à
Bousteau de trouver le sujet des rubriques lui-même. En effet,
lors des deux ou trois fois où je collaborai pour lui, à
chaque fois, même si les sujets étaient très
intéressants, je m’étais retrouvé étranglé
par des délais impossibles à tenir. Si j’étais
parvenu à les tenir, c’était uniquement parce
que ces collaborations étaient restées ponctuelles.
Seulement là il s’agissait d’une rubrique mensuelle.
Aussi, dès notre premier et unique entretien, je prévins
l’aimable rédacteur qu’il était dans notre
intérêt à tous les deux, pour des raisons et
de qualité et de tranquillité d’esprit, qu’il
ne me donnât pas sa rubrique une semaine à l’avance
seulement mais au moins un bon mois.
 Il
faut ici expliquer la difficulté de la tâche. Trois
pages de bande dessinée, c’est bien autre chose que
trois pages de textes purs. Non seulement la densité d’information
risquait malgré tout d’être moindre, bien qu’au
bénéfice d’autres types d’informations propres
au médium, mais la prise de matière risquait préalablement
d’être d’autant plus corsée… En effet,
les sujets donnés par Bousteau risquaient fort de nécessiter
mon déplacement à Paris (ou ailleurs), comme j’habite
à Angoulême, il fallait déjà prévoir
le temps du déplacement. La prise de notes doublée
de la prise d’images nécessitait de ma part soit que
je dessinasse sur le vif avec une extrême spontanéité
(ce qui est l’inverse complet de ma démarche
habituelle) soit que je prisse des photographies ; j’optais
pour la seconde solution… Heureusement, j’avais une caméra
numérique et la possibilité d’exploiter rapidement
par ordinateur les images ainsi collectées… Mais malgré
tous ces facteurs d’optimisation (dus au simple hasard)
pour satisfaire la rédaction on voyait mal qu’une semaine
tout compris, inclus l’envoi (même en Chronopost) des
planches, fut un délais raisonnable ni même rationnel.
Comme je sentais bien que Bousteau, en bon homme de presse, habitué
à « gérer » ce type de situations toujours
sous le mode à la fois de la « charrette » et
de l’hystérie, risquait de ne pas tenir compte de cette
donnée pourtant plus qu’importante, j’en déduisis
qu’il aurait été suicidaire de ma part que j’ajoutasse
à ces difficultés celle de trouver moi-même
le sujet de ma rubrique… En effet, vous imaginez bien que si
j’avais trouvé une rubrique dans des délais qui
me convenaient, il l’aurait sans aucun doute refusée
jusqu’à ce que j’en trouvasse une qui lui convînt
pile dans ses délais à lui… J’essayai une
seule fois de m’amuser à ce petit jeu et j’en eus
la fatale confirmation. Il
faut ici expliquer la difficulté de la tâche. Trois
pages de bande dessinée, c’est bien autre chose que
trois pages de textes purs. Non seulement la densité d’information
risquait malgré tout d’être moindre, bien qu’au
bénéfice d’autres types d’informations propres
au médium, mais la prise de matière risquait préalablement
d’être d’autant plus corsée… En effet,
les sujets donnés par Bousteau risquaient fort de nécessiter
mon déplacement à Paris (ou ailleurs), comme j’habite
à Angoulême, il fallait déjà prévoir
le temps du déplacement. La prise de notes doublée
de la prise d’images nécessitait de ma part soit que
je dessinasse sur le vif avec une extrême spontanéité
(ce qui est l’inverse complet de ma démarche
habituelle) soit que je prisse des photographies ; j’optais
pour la seconde solution… Heureusement, j’avais une caméra
numérique et la possibilité d’exploiter rapidement
par ordinateur les images ainsi collectées… Mais malgré
tous ces facteurs d’optimisation (dus au simple hasard)
pour satisfaire la rédaction on voyait mal qu’une semaine
tout compris, inclus l’envoi (même en Chronopost) des
planches, fut un délais raisonnable ni même rationnel.
Comme je sentais bien que Bousteau, en bon homme de presse, habitué
à « gérer » ce type de situations toujours
sous le mode à la fois de la « charrette » et
de l’hystérie, risquait de ne pas tenir compte de cette
donnée pourtant plus qu’importante, j’en déduisis
qu’il aurait été suicidaire de ma part que j’ajoutasse
à ces difficultés celle de trouver moi-même
le sujet de ma rubrique… En effet, vous imaginez bien que si
j’avais trouvé une rubrique dans des délais qui
me convenaient, il l’aurait sans aucun doute refusée
jusqu’à ce que j’en trouvasse une qui lui convînt
pile dans ses délais à lui… J’essayai une
seule fois de m’amuser à ce petit jeu et j’en eus
la fatale confirmation.
Bref, fin décembre, première rencontre…
J’attendais l’équivalent d’une seconde entrevue
pour prendre acte de ce dont nous avions discuté, voire même
d’un contrat pour sceller nos accords. J’attendais surtout
un feed-back quelconque ; il ne vint jamais, jamais avant la première
date de la première rubrique qui me fut donnée, comme
c’était à prévoir, une petite dizaine
de jours avant le rendu définitif des pages… Je fus
immédiatement embarqué dans l’aventure sans aucun
accord, aucun contrat, aucune prise en compte de mes désiderata.
J’étais payé, ça oui, un peu tard mais
payé quand même : de 600 euros nous passâmes
même à 750 euros les trois pages et ce dès la
deuxième rubrique. Sans doute n’avais-je pas trop à
me plaindre… Et tout le monde de me féliciter d’avoir
une rubrique de trois pages dans un « grand » magazine
national…
Sauf que, sauf que… Il n’avait était
convenu de rien du tout et encore moins de ce que moi j’avais
demandé avec plus qu’insistance : qu’on me donnât
des délais que je pus tenir.
Arrêtons-nous un instant. Car j’imagine
bien que tout cela reste un peu abstrait. Il faut imaginer la situation
: vous êtes chez vous et vous attendez chaque mois une «
mission », un travail sur lequel vous n’avez aucun renseignement,
aucune possibilité de vous avancer d’une manière
ou d’une autre. La seule chose dont vous êtes absolument
certain, c’est que vous devez rendre trois pages le 21 du mois.
Vous n’avez aucune idée de ce que vous allez faire,
d’où on va vous envoyer et si même vous aurez
le droit de prendre de l’image là où l’on
vous enverra, comme le confirma la deuxième
rubrique sur le musée Dapper à Paris. Tout ça
une semaine à peine avant la date fatidique du 21 du mois.
Mais vous ne savez pas davantage si votre Bousteau national ne va
pas avoir la bonté - un jour, touché par la grâce
- de vous prévenir dès le lendemain du rendu de votre
précédente rubrique - soit le 22, dans un élan
magnanime de royale générosité - pour que vous
puissiez prendre le temps de réaliser vos trois pages confortablement…
Bref, vous ne savez jamais, jusqu’au dernier moment, si on
ne va pas vous envoyer en mission aujourd’hui, demain, après-demain
ou dans dix jours. Tout cela sans contrat, sans concertation, sans
dialogue, sans rien que vos envois de mails s’évanouissant
dans le vent du cyberespace. Conciliants au départ ils devinrent
de plus en plus rageurs et enfin totalement désespérés,
suppliant qu’on respectât l’unique et seule condition
que j’avais posée dès le départ : avoir
des délais, des délais, plus de délais. Là
encore, vous imaginez facilement que dans ces conditions, vous
ne pouvez absolument rien faire d’autre qu’attendre
(le bon vouloir de Beaux-Arts magazine), ce dont ce dernier,
son chef et ses valets (Vincent Bernière en tête, censé
faire un peu le DRH en la matière – ce qu’il fit
autant qu’un liquidateur mandaté pour couler une équipe
salariale dont on ne veut plus) se fichaient éperdument.
Comme j’avais déjà été
traité de cette manière lors des rubriques «
ponctuelles » précédentes (dont j’avais
accepté – à tort, finalement - les conditions,
chose dont je m’aperçus bien trop tard) je me posai
en moi-même cet ultimatum : je ne réaliserais pas trois
rubriques à ce régime là (ce qui n’était
possible pour personne, sauf peut-être pour un Sfar
qui a l’habitude de torcher certaines pages en quelques heures,
ce qui aurait peut-être suffit pour l’occasion –
j’appris d’ailleurs que mon Bousteau avait déjà
demandé à Sfar de collaborer
et que celui-ci, pas fou, avait choisi d’accepter à
ses propres conditions lui aussi, ce qui ne plut guère à
notre anguille de rédacteur…). Ainsi, lors de la troisième
rubrique où je me retrouvai dans une situation complètement
ubuesque (impossible de narrer sa complexité et son inextricabilité
ici…) je décidai de planter Beaux-Arts là,
à peine trois jours avant le bouclage. Je me dis que ce serait
le divorce immédiat et la mise au ban. Ce fut un hourvari
inimaginable à la rédaction ; son chef parti quelque
part aux États-Unis, m’ayant juste dit que je pouvais
l’appeler là-bas (aux États-Unis !) si
j’avais un « problème ». Fatalement je n’eus
pas de rubrique ce mois-ci. Mais les affaires reprirent le mois
suivant, toujours sans aucune concertation, sans aucun moyen d’avoir
un entretien concret avec Bousteau ni une seule réponse à
mes mails. Il n’y eut rien, rien, rien ; rien d’autre
que cette identique façon, de travailler, de mal travailler,
de s’angoisser, de piquer des crises seul dans son coin, de
se faire traiter comme on traite un stagiaire, ce qui est déjà
immonde pour un stagiaire, et de poser des questions face à
un mur de briques. Il est évident qu’à ce rythme
et après un second plantage volontaire de ma part tout s’arrêta
au bout de six rubriques, quelque part vers octobre 2005, sans que
j’obtins jamais un contrat, l’entretien espéré
(qui n’aurait sans doute rien résolu) ni un seul mot
d’explications, évidemment.
Il faut dire que durant cette période, finalement,
totalement bloqué à devoir attendre mes rubriques,
paralysé à ne pouvoir rien faire d’autre, en
fin de droits et sans aucune allocation, je me retrouvai du jour
au lendemain sans plus un seul centime entrant sur mon compte.
Dans votre question initiale (veuillez m’excuser
d’avoir été si long mais je crois que ce type
d’aventure vaut la peine d’être raconté in
extenso) vous me demandiez ce que j’avais retenu de cette
expérience… je crois que le récit parle de lui-même.
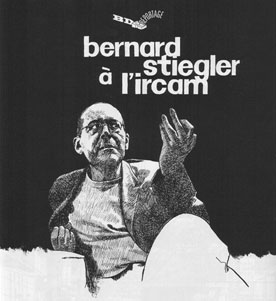 Le
plus pathétique dans cette histoire, c’est que cette
collaboration aurait pu être extraordinaire. Ce ne sont pas
les diverses propositions que je fis au départ qui manquèrent.
Le sujet et l’idée furent extrêmement intéressants.
Vraiment ç’aurait pu être passionnant. Et pour
ne pas être totalement négatif, avec ce risque que
l’on me taxe encore de « faire ma victime » (on
voit mal ici comment je n’ai pas encore été le
dindon de la farce) je dirai que je ne regrette aucune des rubriques
réalisées, à ne considérer que le strict
résultat et bien en dehors des conditions de réalisation.
Les rencontres faites, les expositions visitées, les lieux
parcourus, tout, tout, tout aurait pu être encore plus passionnant
que ça ne l’a été. J’ai tout de même
rencontré Bernard Stiegler qui
m’a quand même reçu alors que je ne pouvais pas
faire autrement que d’arriver en retard au rendez-vous fixé
par Beaux-Arts, puisqu’il m’en avait fixé
un autre à peine deux heures avant avec les gens du Palais
de Tôkyô qui furent, eux, bien moins aimables. Le philosophe
n’avait même pas eu confirmation du rendez-vous (je ne
pouvais pas appeler, je n’ai pas de portable – ce que
Bousteau savait…) et m’a quand même attendu dans
un Ircam fermé à double tour alors qu’il devait
prendre un avion quelques heures plus tard… Il m’a quand
même reçu, disais-je, pour m’exposer son rôle
et son poste en moins d’une demi-heure top chrono, avec une
gentillesse, un professionnalisme et un sens de la pédagogie
hors pair. Inoubliable rencontre pour moi. Bernard
Stiegler aurait mérité au moins vingt pages
pour sa seule demi-heure à moi consacrée ! Je proposai
là aussi de pouvoir faire des rubriques plus longues, plus
approfondies, hors « délais », pour un numéro
ultérieur, ou un hors série… Lettre morte. J’ai
aussi rencontré Jean Nouvel qui
m’a fait visiter le chantier du Musée des arts premiers.
J’ai eu accès à la salle de la Joconde et des
Noces de Cana avant son ouverture… Tout cela fut très
riche. Vraiment nous aurions pu faire des choses incroyables si
Bousteau avait bien daigné écouter mes doléances
ou, simplement, mes propositions. Mais rien, rien, rien. Le
plus pathétique dans cette histoire, c’est que cette
collaboration aurait pu être extraordinaire. Ce ne sont pas
les diverses propositions que je fis au départ qui manquèrent.
Le sujet et l’idée furent extrêmement intéressants.
Vraiment ç’aurait pu être passionnant. Et pour
ne pas être totalement négatif, avec ce risque que
l’on me taxe encore de « faire ma victime » (on
voit mal ici comment je n’ai pas encore été le
dindon de la farce) je dirai que je ne regrette aucune des rubriques
réalisées, à ne considérer que le strict
résultat et bien en dehors des conditions de réalisation.
Les rencontres faites, les expositions visitées, les lieux
parcourus, tout, tout, tout aurait pu être encore plus passionnant
que ça ne l’a été. J’ai tout de même
rencontré Bernard Stiegler qui
m’a quand même reçu alors que je ne pouvais pas
faire autrement que d’arriver en retard au rendez-vous fixé
par Beaux-Arts, puisqu’il m’en avait fixé
un autre à peine deux heures avant avec les gens du Palais
de Tôkyô qui furent, eux, bien moins aimables. Le philosophe
n’avait même pas eu confirmation du rendez-vous (je ne
pouvais pas appeler, je n’ai pas de portable – ce que
Bousteau savait…) et m’a quand même attendu dans
un Ircam fermé à double tour alors qu’il devait
prendre un avion quelques heures plus tard… Il m’a quand
même reçu, disais-je, pour m’exposer son rôle
et son poste en moins d’une demi-heure top chrono, avec une
gentillesse, un professionnalisme et un sens de la pédagogie
hors pair. Inoubliable rencontre pour moi. Bernard
Stiegler aurait mérité au moins vingt pages
pour sa seule demi-heure à moi consacrée ! Je proposai
là aussi de pouvoir faire des rubriques plus longues, plus
approfondies, hors « délais », pour un numéro
ultérieur, ou un hors série… Lettre morte. J’ai
aussi rencontré Jean Nouvel qui
m’a fait visiter le chantier du Musée des arts premiers.
J’ai eu accès à la salle de la Joconde et des
Noces de Cana avant son ouverture… Tout cela fut très
riche. Vraiment nous aurions pu faire des choses incroyables si
Bousteau avait bien daigné écouter mes doléances
ou, simplement, mes propositions. Mais rien, rien, rien.
En outre, je vous ai gardé le meilleur pour
la fin, et ce meilleur fut au début… Il est évident
que le destin de cette collaboration était inscrit dès
son incipit, comme vous aurez pu le constater. Et nous ne
croyions pas si bien dire, en effet, car lors de notre toute première
– et unique, je le répète – concertation,
Bousteau, m’installant dans son bureau, fit appeler son principal
maquettiste pour que nous discutions à trois ; un type que
je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam mais avec qui j'allais
devoir travailler. Il était donc utile que nous nous rencontrions.
Hé bien notre Bousteau ne trouva rien de mieux que de me
le présenter en me disant la chose suivante : « je
te présente Machin. Il n’y tenait pas trop parce qu’il
trouve que tu es un con. »
Ce que je retiens de cette expérience, me
demandiez-vous ?
Que les gens de la presse sont les plus incroyables
goujats que la terre ait portés et qu’ils se comportent
comme des porcs ; ils salissent tout ce qu’ils touchent et
tous ceux qu’ils touchent. Je ne veux plus rien avoir à
faire avec cette engeance.

Vous avez parfois des mots assez durs sur la
presse. Estimez-vous que la bande dessinée est particulièrement
mal traitée par les médias ou au contraire que la
littérature, le cinéma ou la musique, par exemple,
sont logés à peu de chose près à la
même enseigne ?
Indéniablement. Cinéma, musique,
littérature jouissent du même traitement. Mais devrais-je
dire pas tout à fait le même, malgré tout…
Ils sont très mal lotis mais je crains que la bande dessinée
soit encore plus mal critiquée malgré l’indéniable
évolution de ces dernières années sur sa place
médiatique. Ou alors devrais-je dire encore que : oui, la
bande dessinée est désormais aussi mal lotie que le
reste. Son traitement a évolué de totalement inexistant
ou nul à aussi médiocre que le reste. Était-ce
souhaitable ? Je ne sais. Quand on voit le résultat…
Mais je voudrais tout de même tempérer
mes critiques. Non, ce ne sera ni pour retourner ma veste après
coup ni pour laisser entendre que je n’assume pas mes précédents
propos : j’assume tout. Seulement je reste partial car partiel.
Il est évident que tous les journalistes ne sont pas mauvais.
Il est évident que tous les articles ne le sont pas non plus.
Incidemment tous ceux consacrés à mon travail ne le
sont pas également. Il est évident que certains articles
sont mêmes très bons, très élogieux.
On aurait du mal à s’en plaindre. Si je ne décolère
pas de la médiocrité de la presse, c’est bien
dans sa globalité, dans son ensemble, dans sa majorité.
Car à regarder de près, il y a toujours des exceptions
à cette règle, des textes et des gens qui sortent
du lot. Tout le problème est là. Et le pire est que
ce sont souvent les meilleurs d’entre les journalistes qui
se sentent blessés par une attaque sur la globale médiocrité
de leurs collègues…
Je pourrais parler de Jean-Christophe Ogier, par
exemple. Il est sur tous les fronts. Comment pourrait-il faire autrement
? Comment pourrait-on critiquer quelqu’un qui se bat à
France Info et ailleurs pour tâcher de défendre la
bande dessinée ? Comment pourrait-on en vouloir à
l’un des rares journalistes qui répond aux sollicitations
même du « milieu » ? Il y a juste que cela ne
rend pas toujours irréprochables ses articles ou ses positions.
Me concernant, je l’ai toujours trouvé un peu tiède,
un peu dans cette moyenne qui me déplaît tant par ailleurs.
Mais je serais injuste de le critiquer lui parce qu’il est
justement celui qui est le plus visible… Difficile est son
rôle, il ne peut donc pas être à la pointe partout
et tout le temps. Du reste, alors que je le trouvais tiède,
même dans l’ensemble, j’ai été surpris
par l’acuité de sa perception de mon travail dès
qu’il s’est retrouvé en situation d’être
mon unique interlocuteur lors de la rencontre dont j’étais
l’objet au festival de Bastia en 2005. L’une des meilleures
rencontres (pour moi du moins) que j’ai eu à honorer.
J’ai un excellent souvenir également de celle qui eut
lieu à Paris, espace de la Maroquinerie en 2003, lors de
la parution de mon tome 4.
J’ai non moins un excellent souvenir de celle que me consacra
Amiens dernièrement, début octobre 2006, menée
par Patrick Merliot.
Tout cela n’est-il qu’une question de
temps consacré à tel ou tel ? Qu’une question
de place dans tel ou tel canard ? D’accélération
du temps même dû au mode de fonctionnement de notre
société ? Sans doute. Mais alors n’est-ce pas
le rôle d’un critique, peut-être pas d’un
journaliste, que de faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’abstraire
des contingences matérielles qui obligent à “produire
du texte” pour atteindre à une vraie hauteur de vue
sur le travail d’untel ? Les exemples que je cite en font l’illustration
[lien]. Il est évident
que tout cela est bien affaire de niveau et que le niveau
visible, apparent, celui qui occupe la bande passante, est extrêmement
bas. Quand Christophe Steffan (Signé Fufu) fait une critique
très construite d’un seul extrait de la scène
de mon tome 3, pour cependant
proposer un jugement moral sur le narrateur et, incidemment, l’auteur,
sa hauteur de vue est tout à fait respectable. Quand LL-d-M
fait sa violente critique de mon tome
4 [cf citation], même
si cela me blesse, même s’il y a deux ou trois tournures
discutables, il est indéniable que nous sommes à un
tout autre niveau que la prose dégueulasse d’un Joël
Rumello de La Provence. Il est même indéniable
que cela est au-dessus de bien des éloges tièdes et
fausses que j’ai pu lire ou entendre, avec ce style “Mireille
Dumas” à dégueuler me flattant complaisamment
tout en m’enfonçant dans les ornières du “douloureux
problème de l’homosexualité en province”,
du “sans concessions ni fausse pudeur” et autre “avec
son trait fin et précis en noir et blanc”.
Encore une fois, tout cela est affaire de style.
Mais le style fait l’homme. Le style fait la pensée.
Et dans une époque où les professeurs devenus des
“profs” (perdant deux syllabes d’un coup) parlent
aussi mal que leurs élèves, où les journalistes
ne s’entendent même plus se répéter entre
eux lorsqu’ils appliquent en décalcomanie des formules
du style “jouer dans la cour des grands”, lorsqu’ils
vendent la mèche sur l’identité d’un Frantico
sous prétexte que “tout le monde le sait”, lorsqu’ils
ne donnent toujours qu’un éclairage unilatéral
sur un livre pour que le lecteur, pris pour un con, puisse mettre
une ou quatre étoiles et “recommander” ou non l’ouvrage
en question, on peut difficilement parler ici même de style.
Le style est mort. La forme avec lui. Et cela revient
à rejoindre plus haut votre question sur la fiction : si
l’on doit pouvoir lire une autobiographie comme une fiction.
Je réponds ici que tout est affaire de forme ou de style,
de langue et de langage, de niveaux de culture. Mais ce serait m’engager
encore bien loin que de partir sur ces chemins-là…

Dans le dernier
numéro de Bananas (publié au printemps 2006) a
été publié un extrait inédit du Journal
(III). Y a-t-il d'autres passages laissés de côté
tels que celui-ci ?
Oui. Mais celui-ci était le plus exploitable.
En fait j’ai beaucoup de « chutes ». Sauf que,
souvent, ce sont des séquences d’à peine trois
cases ou quatre ou cinq… Difficile de les intégrer par
la suite ailleurs ; elles sont souvent le cours d’une réflexion
que j’ai abandonné. Il y a donc très peu de scènes
complètes ou quasi complètes que j’aurais supprimées
par la suite.
Cet extrait présente notamment l’intérêt
de mettre particulièrement en valeur la similitude de votre
oeuvre avec la musique (contrepoint, rythme...). Pour quelle raison
l’avez-vous laissé de côté à l'époque
de la parution du Journal (III)
? Était-ce pour un problème d'équilibre général
?
Oui, on peut dire ça. Je me suis surtout
dit que si je devais aborder la musique comme un thème en
lui-même, un sujet ou une « forme » même
qui préside souvent à la forme de mes récits,
il fallait que j’y consacre au moins une soixantaine de pages
ou bien que j’intègre cette thématique dans tout
un livre. Cela aurait complexifié peut-être à
outrance la construction déjà fort élaborée
du tome 3.

Dès le début de votre œuvre
vous avez abordé des sujets de société ; au
début c’était très lié à
des problèmes que vous rencontriez personnellement (exclusion
due à l’homophobie ou au chômage par exemple).
Dans des récits plus récents, vous abordez des sujets
plus directement politiques, que ce soit des questions de politique
locale dans l'album sur la
Maison des auteurs (dénigrement par les socialistes locaux
du projet de cette maison), ou de politique nationale dans "J’appelle
à un octobre rouge" dans lequel vous caricaturez
certains de nos dirigeants politiques nationaux. Vous considérez-vous
comme un auteur engagé, politique ?
Oui. Je ne cesse d’ailleurs de dire que le
projet du Journal est essentiellement politique. Il y a juste
que, de manière directe et concrète je suis assez
nul en matière politique. Je vote à gauche, même
très à gauche alors que pour beaucoup de gens je passe
pour un réactionnaire très à droite… C’est
plutôt cocasse. Ceci étant, j’ai une vision large
de la politique comme étant quasiment la totalité
du « vivre ensemble ». Il y aurait presque chez moi
une confusion ou une identité entre éthique et politique,
finalement… mais s’il faut parler de politique de manière
concrète, au sens strict et « médiatique »
du terme, je pense qu’il faut plutôt regarder du côté
de Philippe Squarzoni et surtout de
son récent Dol qui vient de paraître chez Les
Requins marteaux.

Vous publiez parfois des illustrations dans
la presse (par exemple dans le magazine régional Actualité
Poitou Charentes ou dans le magazine du Biarritz Olympique,
Vie ovale). Est-ce par plaisir, pour diversifier votre travail,
ou principalement pour des raisons alimentaires ? (Je dois avouer
que quand je vois la tendresse que vous avez mise dans vos portraits
des joueurs du Biarritz Olympique, j’aurais tendance à
pencher pour la première hypothèse…)
Hé bien c’est un peu de tout ça
à la fois, en fait. J’ai d’assez bonnes relations
avec les gens d’Actualité Poitou-Charentes…
Est-ce que parce que c’est une revue régionale (qui
est d’ailleurs d’excellente tenue) que ses responsables
n’ont pas le même comportement que les odieux personnages
de la presse parisienne ? Je ne sais. J’aurais tendance à
croire que oui, finalement. Les portraits des joueurs du Biarritz
olympique sont le résultat d’une circonstance totalement
imprévue et j’ai un bon souvenir de ce travail. Bémol
: je devais réaliser un grand reportage dessiné au
cœur du club mais je n’ai plus eu de nouvelles et, là
aussi, on ne répond plus à mes mails… Est-ce
parce que jeter au cœur des vestiaires d’un club de rugby
un gay ouvertement gay qui ne cache pas son goût pour les
robustes gaillards a effrayé quelques frileux biarrots ?
Je ne le saurai jamais. Mais je pense que cette aventure aurait
pu être autrement plus intéressante et plus sereine
que l’hystérie bozardeuse…


On note une introduction notable de l'humour
dans vos planches, tout spécialement à partir des
Riches heures et de façon
particulièrement marquée dans certains récits
courts (Outrages notamment),
aussi bien dans le ton que dans le dessin (introduction de personnages
'cartoonesques'). Est-ce lié seulement à votre
état d’esprit lors de la période relatée
dans ces pages ou également à une évolution
du mode de narration ?
J’avoue avoir du mal à donner une
réponse claire à cette question. Je pense que c’était
lié à mon état d’esprit que je voulais
illustrer par un changement de ton, un changement de style. Je crains
cependant de devoir revenir à l’unité de style
et de ton ancienne mode… Je ne suis pas un grand marrant.

Vous avez travaillé plusieurs années
à la Maison des auteurs. Qu'est-ce que le travail en atelier
vous a apporté ? Un certain confort ? Des conseils et encouragements
réciproques ? Quelles ont notamment été les
interactions avec Xavier Mussat et Philippe
Squarzoni, avec qui vous avez partagé votre espace
de travail ?
Là aussi, ma présence à la
Maison des Auteurs est plutôt circonstancielle… Comme
je suis l’un des auteurs à l’origine même
du projet, on m’a un peu accordé une place dans un atelier
(comme à Xavier) à titre
quasi « honorifique » car, en soi, je n’ai jamais
aspiré à travailler en atelier. L’expérience
n’a fait que prouver mes soupçons. Certes, je ne regrette
pas mon passage à la Maison des Auteurs. J’y ai rencontré
quelques personnes avec qui j’ai eu d’excellentes relations.
On peut penser à Philippe Squarzoni,
bien entendu, mais aussi à Jimmy Beaulieu
et son amie Mélissa Beaudry. Je garde le contact outre-Atlantique
avec eux avec le secret espoir de pouvoir les rejoindre quelque
temps au Québec… Il y a l’arrivée très
récente de Lucas Méthé,
un jeune auteur venu de chez Terrenoire et qui a publié un
livre à Ego comme X. C’est un dessinateur remarquable
et un garçon d’une incroyable maturité, oserais-je
dire « pour son âge ». Hélas, je ne suis
plus à l’atelier. Mais on va se voir souvent je pense.
Je peux difficilement faire l’impasse sur
Pili Muñoz et Brigitte Maccias qui gèrent au quotidien
le grand paquebot. Nous avons eu d’excellentes relations tout
du long. Peut-être ai-je été d’une certaine
manière privilégié aussi, je ne sais pas. Mais
je vais devoir faire une rupture assez franche pendant quelques
temps avec cet atelier dans lequel j’ai vécu presque
chaque jour depuis quatre ans… Il faut que je reprenne mes
marques chez moi.
 Cependant
ce serait mentir que de dire que cette expérience a été
bénéfique pour mon travail. Comme je n’ai pas
vraiment « demandé » à être en atelier,
comme je l’ai dit plus haut, et comme l’histoire le prouve
dramatiquement avec mon absence éditoriale hormis ce dont
nous avons parlé (pas de Journal depuis 2002, pile
mon entrée à la MDA), je n’ai quasiment pas avancé
sur le coeur de mon travail depuis quatre ans. J’aurais du
mal à expliquer pourquoi et à donner une seule raison
à cette crise. Mais, pour le coup, le passage à la
Maison des Auteurs n’a pas réussi à me remotiver
de ce côté-là, même si je n’ai pas
passé quatre ans à rien y faire… Il faut dire
que l’accès à Internet illimité, chose
que j’ai découverte là-bas, a considérablement
altéré ma production et même mon jugement…
C’est une véritable drogue avec une véritable
addiction. Je peux m’en passer quand je ne l’ai pas mais
je suis incapable de me discipliner quand je sais que l’écran
est là. Aussi, bien que j’ai considérablement
élargi mon éventail de productions en quatre ans (j’ai
commencé notamment un travail photographique qui n’est
pas totalement accessoire…) j’ai aussi passé d’innombrables
moments à des baguenaudages peu enviables sur le Web. Depuis,
je suis maudit et je me traîne comme un drogué. Ha,
ha. Cependant
ce serait mentir que de dire que cette expérience a été
bénéfique pour mon travail. Comme je n’ai pas
vraiment « demandé » à être en atelier,
comme je l’ai dit plus haut, et comme l’histoire le prouve
dramatiquement avec mon absence éditoriale hormis ce dont
nous avons parlé (pas de Journal depuis 2002, pile
mon entrée à la MDA), je n’ai quasiment pas avancé
sur le coeur de mon travail depuis quatre ans. J’aurais du
mal à expliquer pourquoi et à donner une seule raison
à cette crise. Mais, pour le coup, le passage à la
Maison des Auteurs n’a pas réussi à me remotiver
de ce côté-là, même si je n’ai pas
passé quatre ans à rien y faire… Il faut dire
que l’accès à Internet illimité, chose
que j’ai découverte là-bas, a considérablement
altéré ma production et même mon jugement…
C’est une véritable drogue avec une véritable
addiction. Je peux m’en passer quand je ne l’ai pas mais
je suis incapable de me discipliner quand je sais que l’écran
est là. Aussi, bien que j’ai considérablement
élargi mon éventail de productions en quatre ans (j’ai
commencé notamment un travail photographique qui n’est
pas totalement accessoire…) j’ai aussi passé d’innombrables
moments à des baguenaudages peu enviables sur le Web. Depuis,
je suis maudit et je me traîne comme un drogué. Ha,
ha.
Cet enretien a été réalisé
par e-mail entre le 9 octobre et le 6 novembre 2006.
Vous pouvez lire la suite
de cet entretien ici...
Toutes les images sont © Fabrice
Neaud et les éditeurs (Ego comme X, Beaux arts magazine,
Technic'art, Casterman)
|