Entretien (2ème partie) : Représentation...
 Retour
vers le début de l'entretien. Retour
vers le début de l'entretien.
Sébastien Soleille
: Tous vos dessins reposent-ils systématiquement (au moins
lorsque c'est possible) sur une photographie, un croquis, ou autre
type d’observation directe ? Effectuez-vous souvent des dessins
de mémoire ?
Fabrice Neaud : Disons
qu’avec cette liste vous avez exprimé à peu près…
tous les modes de représentation possible ! Donc il est difficile
de ne pas répondre « oui »…
Il faut repartir de l’intention de départ qui est :
représenter quelqu’un qui existe ou qui a existé.
C’est-à-dire : quelqu’un que je ne peux pas inventer.
En fait je fais ce que je peux avec ce que j’ai ! À
partir de là, plusieurs scenarii sont possibles :
- Soit j’ai des photographies en ma possession, soit j’ai
des croquis d’observation, soit je n’ai rien.
- Après, soit je peux encore demander à la personne
de poser pour moi (pour des dessins ou des photographies et même
maintenant pour des « films ») soit je ne peux pas.
- Là encore, plusieurs possibilités s’ouvrent
où se ferment devant moi : soit je ne peux pas parce que
la personne n’est plus là (éloignement définitif,
décès…) soit qu’elle ne veut pas.
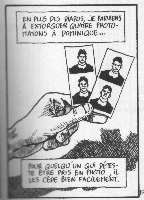 L’idéal,
bien évidemment, c’est la situation 1). Faut-il encore
que la personne veuille bien accepter d’être représentée
dans mon travail. Mais cette situation particulière nous
amène à des développements ultérieurs
qui seraient compliqués de traiter maintenant. Partons de
l’hypothèse (assez fréquente, tout de même)
où la personne accepte d’être représentée.
À partir de là, je n’ai pas de moyens privilégiés.
Vu que je fais un travail précisément sur la représentation,
voire la perception, il est nécessaire pour moi de prendre
en charge tous les modes possibles de captation de l’image
d’autrui. Plus j’en ai, plus facile sera mon traitement
de sa représentation. Plus j’en ai, plus je peux faire
le choix de la représentation adéquate. Car,
en effet, il ne s’agit pas pour moi de transformer des «
personnes » en « personnages »… Il s’agit,
bien au contraire, de leur rendre le plus de justice possible pour
que le lecteur n’échappe jamais à l’idée
que le « personnage » qui est dessiné dans le
livre a une réalité, quelle qu’elle soit, et
que cette réalité dépasse et échappe
malgré tout à la représentation que je vais
en donner. Il ne s’agit donc pas de rendre les « personnages
» identifiables en tant que patronyme : le patronyme
ne dirait rien de la réalité du « personnage
», il se contenterait de marquer le récit comme «
témoignage », ce dont je me fiche éperdument.
C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle
je nomme assez peu, patronymiquement, mes « personnages »,
pour éviter, tant que faire se peut, qu’on identifie
mes récits à des « témoignages ».
Donner le patronyme ne serait pour moi que réciter le mantra
stupide du récit autobiographique classique, avec sa tautologie
bête : « ceci est vrai parce que ceci est vrai ».
Je ne souhaite ni montrer du doigt ni psalmodier bêtement
cette litanie de la « vérité » (des noms,
des êtres, des lieux). Bien plus que cela, je souhaite que
le lecteur ressente que les « personnages » dessinés
sont réels. Pour cela, il me faut bien utiliser toutes les
ressources et tous les pouvoirs de la représentation pour
leur rendre cette justice ! Ce qu’un bête patronyme ne
ferait que court-circuiter, car s’il signe la « réalité
» prétendue de l’être représenté
de manière purement conventionnelle : nous sommes
notre nom et notre prénom, ils fondent notre identité
juridique. Ce qui m’importe, moi, c’est de parvenir
à signer la réalité ontologique de mes «
personnages », leur réalité extra-diégétique…
En cela, il faut donner au lecteur cette impression que je peux
représenter la personne réelle de toutes les manières
possibles de façon à montrer qu’il existe bien,
derrière ses représentations, une réalité.
D’où la nécessité de la photographie et
du réalisme, non pas parce qu’en eux-mêmes
ils sont plus des « marqueurs » du réel que toute
autre forme de représentation, mais parce que rendre efficiente
cette ambition ne peut faire l’impasse sur la première
et encore moins faire l’économie du second. L’idéal,
bien évidemment, c’est la situation 1). Faut-il encore
que la personne veuille bien accepter d’être représentée
dans mon travail. Mais cette situation particulière nous
amène à des développements ultérieurs
qui seraient compliqués de traiter maintenant. Partons de
l’hypothèse (assez fréquente, tout de même)
où la personne accepte d’être représentée.
À partir de là, je n’ai pas de moyens privilégiés.
Vu que je fais un travail précisément sur la représentation,
voire la perception, il est nécessaire pour moi de prendre
en charge tous les modes possibles de captation de l’image
d’autrui. Plus j’en ai, plus facile sera mon traitement
de sa représentation. Plus j’en ai, plus je peux faire
le choix de la représentation adéquate. Car,
en effet, il ne s’agit pas pour moi de transformer des «
personnes » en « personnages »… Il s’agit,
bien au contraire, de leur rendre le plus de justice possible pour
que le lecteur n’échappe jamais à l’idée
que le « personnage » qui est dessiné dans le
livre a une réalité, quelle qu’elle soit, et
que cette réalité dépasse et échappe
malgré tout à la représentation que je vais
en donner. Il ne s’agit donc pas de rendre les « personnages
» identifiables en tant que patronyme : le patronyme
ne dirait rien de la réalité du « personnage
», il se contenterait de marquer le récit comme «
témoignage », ce dont je me fiche éperdument.
C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle
je nomme assez peu, patronymiquement, mes « personnages »,
pour éviter, tant que faire se peut, qu’on identifie
mes récits à des « témoignages ».
Donner le patronyme ne serait pour moi que réciter le mantra
stupide du récit autobiographique classique, avec sa tautologie
bête : « ceci est vrai parce que ceci est vrai ».
Je ne souhaite ni montrer du doigt ni psalmodier bêtement
cette litanie de la « vérité » (des noms,
des êtres, des lieux). Bien plus que cela, je souhaite que
le lecteur ressente que les « personnages » dessinés
sont réels. Pour cela, il me faut bien utiliser toutes les
ressources et tous les pouvoirs de la représentation pour
leur rendre cette justice ! Ce qu’un bête patronyme ne
ferait que court-circuiter, car s’il signe la « réalité
» prétendue de l’être représenté
de manière purement conventionnelle : nous sommes
notre nom et notre prénom, ils fondent notre identité
juridique. Ce qui m’importe, moi, c’est de parvenir
à signer la réalité ontologique de mes «
personnages », leur réalité extra-diégétique…
En cela, il faut donner au lecteur cette impression que je peux
représenter la personne réelle de toutes les manières
possibles de façon à montrer qu’il existe bien,
derrière ses représentations, une réalité.
D’où la nécessité de la photographie et
du réalisme, non pas parce qu’en eux-mêmes
ils sont plus des « marqueurs » du réel que toute
autre forme de représentation, mais parce que rendre efficiente
cette ambition ne peut faire l’impasse sur la première
et encore moins faire l’économie du second.
L’idéal est donc d’avoir : des photographies,
des films, des croquis, des dessins posés et… la mémoire
pour lier le tout et comprendre comment se re-présente la
personne à ma perception. Les cas les plus simples
sont évidemment les amis où les gens suffisamment
proches de mon travail et au fait de ce que j’en fais (je veux
dire le plus loin possible du fantasme smolderenien de la
soi-disant « prédation » que j’opèrerais
sur mes modèles) pour se prêter au jeu d’être
les modèles d’eux-mêmes. Je parle des êtres
extra-diégétiques que sont «
Denis », « Xavier », « Loïc »,
etc.
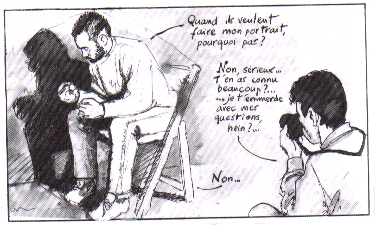 Pour
être concret et en faisant encore abstraction, pour quelques
temps, du droit des modèles à refuser d’être
représentés, je dirai que pour « Stéphane
», par exemple, je disposais d’une quarantaine de photographies
et d’une dizaine de dessins. Je les ai tous utilisés
pour la réalisation du tome
1 du Journal. Idem pour « Dominique ». Pour
être concret et en faisant encore abstraction, pour quelques
temps, du droit des modèles à refuser d’être
représentés, je dirai que pour « Stéphane
», par exemple, je disposais d’une quarantaine de photographies
et d’une dizaine de dessins. Je les ai tous utilisés
pour la réalisation du tome
1 du Journal. Idem pour « Dominique ».
Certains modèles, plus lointains, se sont dérobés
d’une autre manière à la représentation…
Par exemple, il m’est difficile d’obtenir une photographie
d’un amant de passage, par exemple ! Ce qui paraît assez
logique… Mais si j’ai nécessité à
raconter le « passage » de cet amant, ce sera souvent
pour dire quelque chose qui aura plus lien avec la « situation
» vécue qu’à la réalité de
l’être : il devient alors légitime « d’inventer
» un personnage qui aurait très bien pu être
un autre dans la réalité elle-même…
Après, tous les cas de figure qu’offre le réel,
ce grand pourvoyeur d’empêchements de tourner en rond,
m’amène souvent à des cas limite, comme l’absence
du modèle initial ou sa disparition. Sans compter son possible
refus d’être représenté, ce qui nous amène
à des abîmes de difficultés pour mener à
bien mon projet !

Vous avez été beaucoup attaqué
pour avoir représenté des personnes réelles
(voir notamment le volume III).
Une de vos réactions a été, dans 'Émile
– du printemps 1998 à aujourd'hui (histoire en cours)',
de ne représenter personne... Ces attaques ont-elles modifié
votre manière de procéder ? Demandez-vous maintenant
par exemple l'autorisation des personnes représentées
(comme c’est suggéré, au moins pour certains
personnages, par les dédicaces des 'Riches
heures') ?
Sur la modification de ma manière de procéder : et
comment ! Comme vous l’avez signalé avec Émile,
de violentes critiques, découvertes par hasard sur le Net
à l’époque de la parution de ce récit,
en 2000, m’ont complètement inhibé, pour rester
pudique. J’avais initialement prévu de dessiner, finalement,
le fameux « Émile » dans ce court récit. Mais
la lecture des critiques, essentiellement formulées par un
certain Thierry Smolderen à l’égard
de la représentation du « Dominique » de mon
tome 3 du Journal, sur lesquelles nous aurons l’occasion
de revenir et que j’ai déjà évoquées,
m’ont tellement affecté et blessé, m’ont
tellement donné mauvaise conscience que je me suis interdit
de représenter Emile alors qu’il était prévu
que je le fis.
Demander une autorisation aux personnes que je représente
? J’aimerais bien, parfois !
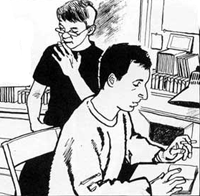 Mais
qu’on se demande un peu ce que représente une telle
entreprise en régime autobiographique. Vous imaginez bien
qu’il ne doit pas être trop trop dur de demander l’autorisation
d’utiliser l’image d’autrui quand il s’agit
d’amis. Vos amis vous font confiance et vous leur faites confiance,
pensez-vous. Sauf que même dans ce cas précis, c’est
déjà très compliqué ! Le seul fait de
leur demander une autorisation écrite nourrit le soupçon
: « mais qu’est-ce que tu veux vraiment raconter pour
que tu aies besoin de mon autorisation ? » Aussi êtes-vous
tenu de leur dire, par le menu, ce que vous allez leur faire dire
dans votre travail… Aussi n’avez-vous plus aucune liberté
de manœuvre pour articuler votre récit par la suite.
La moindre modification des propos tenus par un de vos « personnages
» représentants un ami exige de vous que vous redemandiez
l’autorisation en la reformulant. Impossible de faire une autorisation
sous forme « forfaitaire », cela laisserait à
vos amis le loisir de penser que cette autorisation vous dédouane
de tous les propos que vous souhaitez leur faire tenir, de toutes
les situations dans lesquelles vous souhaitez les faire figurer.
Un vrai casse-tête qui fiche d’emblée une ambiance
malsaine entre eux et vous. Mais
qu’on se demande un peu ce que représente une telle
entreprise en régime autobiographique. Vous imaginez bien
qu’il ne doit pas être trop trop dur de demander l’autorisation
d’utiliser l’image d’autrui quand il s’agit
d’amis. Vos amis vous font confiance et vous leur faites confiance,
pensez-vous. Sauf que même dans ce cas précis, c’est
déjà très compliqué ! Le seul fait de
leur demander une autorisation écrite nourrit le soupçon
: « mais qu’est-ce que tu veux vraiment raconter pour
que tu aies besoin de mon autorisation ? » Aussi êtes-vous
tenu de leur dire, par le menu, ce que vous allez leur faire dire
dans votre travail… Aussi n’avez-vous plus aucune liberté
de manœuvre pour articuler votre récit par la suite.
La moindre modification des propos tenus par un de vos « personnages
» représentants un ami exige de vous que vous redemandiez
l’autorisation en la reformulant. Impossible de faire une autorisation
sous forme « forfaitaire », cela laisserait à
vos amis le loisir de penser que cette autorisation vous dédouane
de tous les propos que vous souhaitez leur faire tenir, de toutes
les situations dans lesquelles vous souhaitez les faire figurer.
Un vrai casse-tête qui fiche d’emblée une ambiance
malsaine entre eux et vous.
Ainsi, le seul fait de demander une autorisation peut suffire à
vous brouiller d’avance avec certains d’entre vos amis.
Je ne vous parle pas de la lourdeur devenant toute administrative
qui s’immisce entre eux et vous. Cette histoire d’autorisation
devient quasiment un travail à plein temps !
… Alors je vous laisse imaginer quand les
représentations d’autrui ne sont pas celles de
vos amis.
Alors on fait les choses à moitié.
On demande à certains, mais oralement, pas à d’autres.
Pour ma part, je n’ai aucune autorisation écrite de
qui que ce soit car, selon ce que j’ai dit précédemment,
c’est tout bonnement impossible d’obtenir de telles autorisations.
Sans compter, là aussi, qu’en dehors de vos amis, vous
vous interdisez tout point de vue un tant soit peu critique sur
qui que ce soit avec ce genre de procédure ! Intervient donc
la fameuse et péniblissime autocensure. C’est ce qui
c’est passé avec le récit Émile.

Vous travaillez à partir de l’image des autres,
à partir de documents visuels ; n’avez-vous pas peur
de vous faire attaquer pour atteinte à la vie privée
ou pour copie de documents sous copyright ?
Nous y voilà.
La législation en matière d’utilisation ou de
représentation de l’image d’autrui en France est
au moins aussi draconienne et castratrice qu’aux États-Unis
à qui nous n’avons rien à envier en ce domaine.
Tout est dit dans l’article 226 du Code pénal sur ce
qui est défini comme étant « l’atteinte
à la vie privée ». Je rappelle, en bref, l’article
226-1, par exemple (le citer in extenso serait un peu long) :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque,
volontairement de porter atteinte à l'intimité de
la vie privée d'autrui :
« 1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le
consentement de leur auteur, des paroles prononcées à
titre privé ou confidentiel ;
« 2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le
consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans
un lieu privé.
« Lorsque les actes mentionnés au présent article
ont été accomplis au vu et au su des intéressés
sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient
en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
»
Partant de là, il est évident que l’utilisation
de l’image d’autrui pose un sérieux problème.
Je renvoie en partie à votre question précédente
et à la réponse que j’ai tenté de faire.
Mais on pourrait étendre la problématique à
l’utilisation d’autres images : les images publicitaires,
les marques, les lieux privés… En gros, il y a trois
grandes catégories de problèmes juridiques potentiels
liées à l’image :
- l’utilisation d’une marque ou de l’image d’une
société existante, voire d’un lieu ou objet
appartenant à un sujet privé,
- la reproduction ou l’inspiration d’une œuvre
déjà existante,
- l’utilisation de l’image d’autrui.
1) Il est paradoxal de constater, par exemple, que les marques
et la publicité s’imposent à nous dans l’espace
public alors qu’elles nous interdisent explicitement de les
utiliser à notre tour dans une œuvre.
Je crois pouvoir ajouter qu’en France nous
sommes encore à peu près protégés contre
la dictature des marques qui polluent notre espace visuel, l'espace
public et revendiquent le droit au contrôle absolu de leur
représentation… Pourtant, nous n'y sommes pour rien
si dans notre réalité nous sommes infectés
par la représentation de telle ou telle marque. Les marques,
et les firmes qui les sous-tendent, ont cette prodigieuse prétention
à vouloir s'imposer à nous, de le faire, mais refusent
qu'on retourne contre elles les armes mêmes qu'elles utilisent
pour nous infecter. Si juridiquement le problème peut être
assez épineux (il vaut mieux ne pas se frotter aux marques)
c'est philosophiquement et moralement inadmissible et scandaleux
: un pan même de la réalité visible se dérobe
juridiquement à la représentation !
Je crois que l’un des devoirs d’un auteur
est de se coltiner avec ce type de scandale et de refuser de se
voir dicter par l'extérieur ce qu'il peut ou non représenter.
Il me semble défendable d'alléguer le droit à
la polémique, à la citation et, surtout, à
la représentation. Nier l'existence des marques et/ou les
détourner avec cet éternel second degré en
modifiant un brin le nom d'une marque me semble être l'aboutissement
même du scandale. Ou comment l'humour lui-même devient
le valet des marques et parvient à faire abdiquer le travail
des auteurs à leurs diktats. Le cinéma et la télévision
ont cédé aux injonctions des marques. Ne serait-il
pas du devoir de la bande dessinée d'y résister ?
Pour ma part, je réclame le droit de représenter la
réalité sans détour et si, dans mon espace
visible, apparaît une marque, j'estime avoir le devoir de
ne pas la faire disparaître parce que celle-ci aurait la volonté
de s'imposer ici mais prierait qu’on l’ignorât là.
2) Le cas de la reproduction d’une œuvre déjà
existante est assez complexe. Car il y a le droit de reproduction,
le droit de citation et le droit d’inspiration.
Le droit de citation n’en est pas un. En vérité
c’est un usage permis. Dans le cas de la littérature,
il est permis de citer l’œuvre d’autrui à
raison de quelques lignes ou de x caractères (je ne sais
pas combien exactement mais on tolère l’équivalent
d’une dizaine de lignes). Dans le cas de l’image, finalement,
et c’est à la fois curieux et absurde, on n’a pas
le droit de « citer » une image qui n’est pas de
soi. Il faut impérativement demander un droit de reproduction,
qui se monnaye, bien entendu, au prorata d’un rapport de format
entre la page et l’image utilisée. Il serait intéressant
de se pencher sur la cas de la bande dessinée où la
« citation » possible d’une image s’inscrit
dans un langage qui ne fait pas de la case l’unité sémantique
absolue du médium… Mais nous n’en sommes pas là
: la juridiction ne sait toujours pas ce qu’est la bande dessinée
et compte chacune de ses « vignettes » comme une unité
sémantique complète, ce qui est un non-sens, et tranche
donc sur les cas d’utilisation illégale d’images
comme si celles-ci délivraient tout leur sens dans la case
(alors que la case n’a de sens qu’avec celle qui la précède
et celle qui la suit).
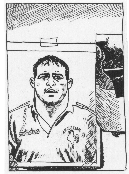 Je
me suis heurté à un autre type de problème
en souhaitant (pour une fois !) demander l’autorisation pour
l’utilisation d’une photographie que j’aurais redessinée
entièrement mais dont j’estimais l’importance sémantique
dans mon travail assez conséquente pour ne pas tenter de
passer outre cette autorisation. Il s’agissait d’un très
beau portrait de Raphaël Ibanez, reproduit dans le Livre
d’or du rugby 1998 et dont les droits étaient détenus
par l’agence de presse Tempsport. Je
me suis heurté à un autre type de problème
en souhaitant (pour une fois !) demander l’autorisation pour
l’utilisation d’une photographie que j’aurais redessinée
entièrement mais dont j’estimais l’importance sémantique
dans mon travail assez conséquente pour ne pas tenter de
passer outre cette autorisation. Il s’agissait d’un très
beau portrait de Raphaël Ibanez, reproduit dans le Livre
d’or du rugby 1998 et dont les droits étaient détenus
par l’agence de presse Tempsport.
J’ai tout d’abord téléphoné à
l’agence pour avoir les coordonnées du photographe.
J’ai été très sympathiquement entendu
par des gens qui semblaient heureux qu’un auteur de bande dessinée
s’intéressât à une de leurs photographies.
Si l’essentiel devait passer par eux, il me fallait aussi l’autorisation
du modèle (Ibanez), l’autorisation de la marque Adidas
(Ibanez arborait un polo avec le logo de la marque bien visible)
et m’acquitter du même droit pécunier que pour
un droit de reproduction. Je ne reproduisais pas la photographie,
je la redessinais. Par ce biais, je ne voulais pas que l’on
crût que j’étais l’auteur de l’image
en question, bien au contraire, mais je citais explicitement, dans
la narration qui était menée autour de cette image,
le fait qu’il s’agissait d’une photographie, que
j’avais vu dans tel livre et qu’elle était bien
le fruit du travail de tel photographe faisant partie de telle agence.
C’est un peu comme si, si vous voulez, je redessinais le baiser
des amants de Doisneau en expliquant
: « je m’appelle Fabrice Neaud
et j’ai été très touché par cette
photographie de Robert Doisneau que
j’ai trouvée dans tel livre ». Hé bien
les gens de Tempsport, toujours ravis, au demeurant, ne comprenaient
quand même absolument pas du tout ce que je voulais leur faire
comprendre. Il y avait entre nous une barrière sémantique
infranchissable et, pour eux, même si cela leur faisait plaisir,
ils ne voyaient pas de différences entre la seule reproduction
de l’image comme si j’avais juste besoin d’un portrait
d’Ibanez comme j’en aurais pris un autre et le fait que
je faisais explicitement un travail autour de cette image
précise en la contextualisant de la manière la plus
précise qui fut.
Inutile de vous dire que, pour l’heure, j’ai abandonné
l’affaire et laissé le dessin en question dans mes cartons.
Les complications apportées par la simple « citation
» de cette image me parurent insurmontable, sans compter que
j’aurais dû m’acquitter, au bout du compte, d’une
somme au moins aussi importante qu’une partie de mes droits
d’auteur à moi sur le livre qui aurait cité cette
photographie.
La législation sur l’image, finalement, considère
la bande dessinée comme le cinéma. Un auteur de bande
dessinée, s’il s’acquittait de tous les droits
qu’il doit aux divers auteurs, sociétés, marques,
gens auxquels il emprunte un nom, une image, une photo, aussi restreinte
soit l’utilisation qu’il en ferait, devrait leur consacrer
le même budget que le cinéma ! Or le budget pour un
film n’est pas celui de la bande dessinée et il y a
une équipe complète pour s’occuper de ça.
La richesse de la bande dessinée, c’est que l’on
peut être seul et fabriquer un livre avec du papier et un
crayon, uniquement. Or la législation sur le droit à
l’image, quelle qu’elle soit, interdit ontologiquement
à la bande dessinée le droit de parler tout simplement
de la réalité, de la représenter, avec les
marques qui la polluent, les images qui la peuplent et qui appartiennent
à d’autres mais qui sont là, autrement qu’en
la travestissant et qu’en mentant sur ce qu’elle est :
un tissu poreux et un réseau fait de mutisources à
multiniveaux.
Ainsi, l’entreprise de parler du réel, qu’il soit
autobiographique ou documentaire, est interdit à la bande
dessinée si celle-ci veut jouer le jeu de la stricte légalité
procédurière. Il est bien évident que face
à ce dilemme il n’y a pas trente-six choix et je soupçonne
la bande dessinée d’être toujours restée
dans les langes de sa neuneuterie constitutive pour cette raison-là,
fut-elle inconsciente.
3) Certes, je n’ai pas totalement répondu à
votre question, j’ai même botté en touche en glissant
des personnes privées aux marques, des marques aux images
créées par d’autres… Cela peut paraître
un faux-fuyant. Mais je ne me déroberai pas plus longtemps
à cette question. Bien qu’une personne privée
aurait davantage de raisons de se sentir lésée si
on la représente contre son gré dans une œuvre
qu’une marque ou qu’une société – qui
ont déjà mille fois plus la possibilité de
se défendre et ne s’en prive généralement
pas – je considère que le problème, du point
de vue de l’auteur, est le même. Surtout concernant une
œuvre autobiographique.
Je trouve assez malhonnête et lâche, pour le coup,
de « modifier » les visages, les noms et les lieux dans
une œuvre autobiographique. Je me suis déjà expliqué
à ce sujet, sur le fait que dessiner quelqu’un d’autre,
« d’inventer » le visage de quelqu’un qui
existe dans notre entourage, si c’est moralement louable, assez
peu dérangeant pour le lecteur avec l’avantage de préserver
la personne privée qu’on épargne alors, je trouve
que ce n’est pas esthétiquement ni plastiquement ni
intellectuellement neutre. Voilà, c’est exactement ça,
en fait. Modifier le visage de quelqu’un n’est tout bonnement
pas neutre. Je l’avais mis en perspective dans le
tome 3 : si je dessine quelqu’un d’autre que celui
ou celle qui compte pour moi, je ne raconte déjà
plus la même histoire.
Le problème est insoluble : soit on se passe de la représentation,
soit on représente sans fards (je considère que la
modification fait renter l’œuvre dans un autre champ qui
n’est pas celui qui nous préoccupe ici). Car ce n’est
pas anodin. Ce n’est pas neutre. Et, bien évidemment,
on se heurte à la possibilité déjà de
blesser autrui, puis la possibilité d’aller au devant
de problèmes juridiques graves (retrait de l’œuvre,
amende, procès…).*
Savoir si j’ai peur ? Bien entendu que j’ai peur ! Je
suis terrorisé à chaque fois que j’y pense !
Si bien que, comme je l’ai déjà dit, je suis
régulièrement paralysé devant ma page blanche
quand je dois dessiner quelqu’un dont je ne suis pas certain
que son image lui siéra (sachant que même si nous avons
l’accord de la personne en question, elle peut changer d’avis
– c’est capricieux ces petites bêtes-là…).
Mais je le fais quand même.
Simplement parce qu’il s’agit de marques, de sociétés,
de lieux privés, d’images qui ne m’appartiennent
pas ou de gens, je considère qu’il est de mon devoir
d’auteur de rendre compte comme je l’entends de la réalité
qui m’entoure et que je n’ai pas à m’autocensurer
en me demandant à l’avance si je ne vais pas gêner
tel ou telle ou bien risquer d’aller aux devants de tel ou
tel problème de droits. J’essaie d’être le
plus honnête possible. Dans le cas de « citation »,
je m’arrange systématiquement pour que la « source
» soit citée et dans le cas des gens, ma foi, je me
suis déjà expliqué à ce sujet : on n’est
jamais à l’abri de leurs caprices, même s’ils
vous donnent leur accord. Et je vous assure que je m’autocensure
déjà bien assez en amont de mes pages, croyez-moi
!

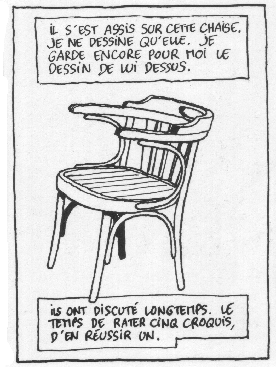 Vous
avez déjà évoqué l’importance pour
vous de représenter l’être aimé et le fait
qu’il n’est pas pertinent de travestir son image (dans
Les Riches Heures notamment)…
Comme je le rappelais tout à l'heure, dans Émile
– du printemps 1998 à aujourd'hui (histoire en cours),
vous avez choisi de ne pas représenter l'être aimé.
A priori, cela ne semble pas être une solution viable de façon
durable. Comment envisagez-vous de procéder à l’avenir,
notamment en cas d’histoires d’amour en cours ? Vous
avez déjà évoqué l’importance pour
vous de représenter l’être aimé et le fait
qu’il n’est pas pertinent de travestir son image (dans
Les Riches Heures notamment)…
Comme je le rappelais tout à l'heure, dans Émile
– du printemps 1998 à aujourd'hui (histoire en cours),
vous avez choisi de ne pas représenter l'être aimé.
A priori, cela ne semble pas être une solution viable de façon
durable. Comment envisagez-vous de procéder à l’avenir,
notamment en cas d’histoires d’amour en cours ?
Hé bien disons que, pour l’heure, l’avenir m’a
réservé d’autres surprises que je ne croyais
pas possible : une baisse considérable de tonus, comme nous
l’avons déjà vu. Je pense que ce souci lié
à la représentation d’autrui n’y est pas
étranger.
Comme vous le dites, cette solution n’est
absolument pas viable sur le long terme. Je ne peux tout de même
pas dessiner toute la suite de mon journal sans représenter
personne ! Ca peut être amusant sur quelques dizaines pages,
prendre ça comme un procédé oubapien, mais
cela finirait fatalement par être réducteur dans le
projet. Cela a donné lieu à une relative « réussite
» avec Émile, mais je tiens à vous assurer que
c’était purement fortuit. Comme la suite de mon journal
devrait comprendre quatre gros tomes qui vont développer
tout ce court récit paru dans
Ego comme X n°7, j’aime mieux vous dire que je ne peux
pas m’amuser à faire un millier de pages sans représenter
Émile et, a fortiori, sans représenter personne !
La contrainte oubapienne, c’est rigolo cinq minutes, et quand
on se l’impose à soi-même, mais quand c’est
une censure externe ou, ici, une autocensure, c’est parfaitement
ridicule.
Mais le destin, pour retors qu’il soit, m’a un peu favorisé
sur ce coup là. De la même manière que le «
Stéphane » du tome
1, mon Émile avait disparu de la circulation… En plus,
ce qui rejoint votre septième question, je n’avais alors
presque aucune photographie d’Émile. Non seulement je n’avais
pas « d’autorisation » de représenter Émile
de sa part mais, techniquement, je ne pouvais effectivement pas
le dessiner : trop peu de documents pour lui rendre hommage.
Je ne rentrerai pas dans les détails de la petite histoire
mais le plus grand des hasards m’a ramené mon Émile
en 2002 et j’ai obtenu de lui non seulement trois grosses pellicules
photos de portraits sous tous les angles mais également (ce
qui allait avec) sa « permission » de le dessiner dans
mes prochains épisodes… J’en profiterai à
l’occasion pour le gratifier de son vrai prénom : Antoine.
Ouf…
Je suis très heureux.
Ne reste plus qu’à souhaiter que le jeune homme (qui
a de nouveau totalement disparu de la circulation) ne me fasse pas
le coup du « caprice » en voyant le livre sorti…
Reste la question de savoir pour le cas d’un « amour
en cours »… Dieu merci, personne ne veut de moi donc
je n’ai pas eu encore à me poser la question, ha, ha,
ha. Mais cela ne changerait pas grand-chose à mon optique,
en théorie. Tout cela est du cas par cas. Nous verrons bien.
Je considère aussi que les gens sont censés
me connaître, aussi. Du moins ceux qui m’entourent. Je
ne vais pas faire tout le boulot d’explication, d’étude
de texte, à chaque nouvelle relation. Ceux qui me connaissent
ont actuellement quatre livres pour se faire une opinion sur moi
– si tant est que des fâcheux style Thierry
Smolderen n’aient pas la malhonnêteté intellectuelle
de pourrir par « principe de précaution »
et mon existence et mon œuvre par avance, avec une lecture
réductionniste de mon travail, comme je l’ai dit plus
haut.
Cet entretien a été réalisé
par e-mail entre le 21 mai et le 8 juin 2007.
Toutes les images sont © Fabrice
Neaud et les éditeurs (Ego comme X, L'Association)
|