Discussion avec Fabrice Neaud (1) - Bande dessinée
actuelle et "bonhomme patate"
Sébastien Soleille : Vous tenez-vous
au courant des bandes dessinées qui paraissent actuellement
?
Fabrice Neaud : Disons que je me suis un
peu mis à distance des parutions contemporaines, surtout
des parutions franco-belges. Comme je suis grand fan de comics,
je me noie davantage dans ce genre de productions. Et je puise plus
facilement d'inspiration en eux parce que, étrangement, c'est
narrativement plus éloigné de ce que je fais. Je me
ressource mieux. Le décalage culturel me permet de mieux
comprendre ce que je fais, ce que nous faisons, ce que nous ratons
ici en France. C'est un peu comme voyager à l'étranger
pour s'immerger dans les grandes différences culturelles,
qui permettent de mieux comprendre nos spécificités...
Mais je l’ai déjà dit, en quelque sorte, dans
mes réponses précédentes. Aussi ne vais-je
pas répéter la liste fastidieuse de mes lectures qui
n’ont pas vraiment changé. Mais pour la bonne bouche,
je peux en citer de nouveau quelques-unes. Je tâcherai de
me concentrer davantage sur les nouveautés.
 J'ai
acheté récemment le tome 5 de Paradise X (Alex
Ross), le premier tome des Guerres secrètes
(le premier grand crossover de l'univers Marvel), Néouniversel
(Warren Ellis), le dernier Planetary,
le dernier Authority, Supreme Power de Strazinsky
et je me délecte. Je surveille toujours en parution kiosque
les X-Men, même si depuis la fin de la saga scénarisée
par Morrisson ça a de nouveau
baissé en qualité, les Astonishing X-Men (la
saga de Cassaday et Wesdon
est vraiment très bien), Les Ultimates (bien que j'ai
des doutes après la saga de Millar
et Hitch) ainsi que le récent
Civil War de chez Marvel... Je suis moins fan de l'univers
DC comics, il serait fastidieux d'expliquer ici pourquoi. Il faut
dire aussi qu'avec mon propre projet de superhéros, j'ai
besoin d'apprendre ce qui se fait pour trouver ma place. Ce n'est
pas simple et mon problème demeure toujours celui du dessin
et d'un manque d'énergie profond. Je relis aussi quelques
mangas qui me font du bien et sont plus en adéquation avec
ma propre écriture : Monster, Parasite, Twentieth
century boys... Très peu d'histoires "intimistes",
en fait. Je n'ai pas besoin de ça. Ce qui se fait dans le
domaine (en France du moins) me paraît très pauvre,
très superficiel. Je suis profondément déçu
par la production actuelle française, hormis le Pascal
Brutal de Riad Sattouf. J'ai
acheté récemment le tome 5 de Paradise X (Alex
Ross), le premier tome des Guerres secrètes
(le premier grand crossover de l'univers Marvel), Néouniversel
(Warren Ellis), le dernier Planetary,
le dernier Authority, Supreme Power de Strazinsky
et je me délecte. Je surveille toujours en parution kiosque
les X-Men, même si depuis la fin de la saga scénarisée
par Morrisson ça a de nouveau
baissé en qualité, les Astonishing X-Men (la
saga de Cassaday et Wesdon
est vraiment très bien), Les Ultimates (bien que j'ai
des doutes après la saga de Millar
et Hitch) ainsi que le récent
Civil War de chez Marvel... Je suis moins fan de l'univers
DC comics, il serait fastidieux d'expliquer ici pourquoi. Il faut
dire aussi qu'avec mon propre projet de superhéros, j'ai
besoin d'apprendre ce qui se fait pour trouver ma place. Ce n'est
pas simple et mon problème demeure toujours celui du dessin
et d'un manque d'énergie profond. Je relis aussi quelques
mangas qui me font du bien et sont plus en adéquation avec
ma propre écriture : Monster, Parasite, Twentieth
century boys... Très peu d'histoires "intimistes",
en fait. Je n'ai pas besoin de ça. Ce qui se fait dans le
domaine (en France du moins) me paraît très pauvre,
très superficiel. Je suis profondément déçu
par la production actuelle française, hormis le Pascal
Brutal de Riad Sattouf.
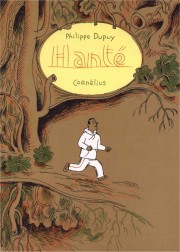 Mais
je me suis forcé. Par exemple, j'ai réussi à
acheter Hanté de Dupuy mais c'est à peu près
tout. Quand j'ouvre un livre en noir et blanc franco-belge censément
"indé" aujourd'hui, ça me tombe des mains.
J'ai l'impression que les auteurs n'ont vraiment plus grand chose
à dire. En tout cas j'ai surtout l'impression qu'il y en
a très peu qui pensent la réalité ou
leur production. C'est difficile à définir. J'ai essayé
de répondre partiellement à ça dans le co-entretien
réalisé avec Jean-Christophe
Menu dans l'Éprouvette n°3. Larcenet
m'indiffère, Blain, Blutch
également. Je ne suis pas sensible à leur univers.
Ca ne me parle absolument pas. Aucun des "jeunes" auteurs
apparus récemment sur la scène éditoriale ne
me touche. J'ai l'impression qu'ils ne font que passer une couche
d'asphalte sur les petits sentiers fragiles et tortueux que nous
avions ouverts. Je ne parle évidemment pas de la production
autobiographique actuelle qui est absolument dégueulasse.
Je n'ai pu aimer que Épuisé de Joe
Matt... qui est anglophone. Mais
je me suis forcé. Par exemple, j'ai réussi à
acheter Hanté de Dupuy mais c'est à peu près
tout. Quand j'ouvre un livre en noir et blanc franco-belge censément
"indé" aujourd'hui, ça me tombe des mains.
J'ai l'impression que les auteurs n'ont vraiment plus grand chose
à dire. En tout cas j'ai surtout l'impression qu'il y en
a très peu qui pensent la réalité ou
leur production. C'est difficile à définir. J'ai essayé
de répondre partiellement à ça dans le co-entretien
réalisé avec Jean-Christophe
Menu dans l'Éprouvette n°3. Larcenet
m'indiffère, Blain, Blutch
également. Je ne suis pas sensible à leur univers.
Ca ne me parle absolument pas. Aucun des "jeunes" auteurs
apparus récemment sur la scène éditoriale ne
me touche. J'ai l'impression qu'ils ne font que passer une couche
d'asphalte sur les petits sentiers fragiles et tortueux que nous
avions ouverts. Je ne parle évidemment pas de la production
autobiographique actuelle qui est absolument dégueulasse.
Je n'ai pu aimer que Épuisé de Joe
Matt... qui est anglophone.
Sébastien Soleille : Je partage un peu
votre désintérêt actuel pour la production franco-belge.
Je me demande d'ailleurs si c'est moi qui suis blasé, qui
ne parviens plus à repérer les auteurs intéressants
parmi les nouveaux venus, ou bien si nous sommes effectivement dans
une période de reflux, après les années 1990
qui furent très riches. J'aime bien votre image des jeunes
auteurs qui « ne font que passer une couche d'asphalte sur
les petits sentiers fragiles et tortueux que [v]ous avi[ez] ouverts
». Il me semble effectivement qu'après l'éclosion
de maisons d'édition innovantes et d'excellents auteurs dans
les années 1990, notamment dans le domaine de l'autobiographie,
nous avons affaire maintenant soit à ces mêmes auteurs
qui, tout en continuant parfois à sortir des albums de qualité,
ont tendance à rester dans une certaine routine, ou à
leurs nombreux épigones.
Votre relatif désintérêt
pour les oeuvres franco-belges et votre tropisme pour les comics
et les mangas sont-ils dus, au moins en partie, à cette évolution
? En d'autres termes, lisiez-vous plus assidûment ce qui sortait
en France quand Lewis Trondheim publiait
Approximativement, David B L'Ascension
du Haut Mal, Jean-Christophe Menu
son Livret de Phamille et Dupuy &
Berbérian le Journal d'un album, par exemple
?
Fabrice Neaud : Il est difficile de répondre à
ces questions. Moi aussi je me demande si je ne suis pas blasé.
Il est évident qu’il doit bien y avoir quelque chose
comme ça. D’aucuns diront que je suis « aigri
» et trouveront tout un tas de raisons pour ne pas lire ni
écouter ce que j’ai à dire sur la production
contemporaine. Cependant, si je veux bien admettre qu’il y
a une part d’aigreur, de ressentiment ou le que je suis blasé
par ce que je vois, j’aimerais qu’on reconnaisse que dans
mes arguments certains sont valables quand je décris le manque
de créativité actuelle des jeunes auteurs.
Oui, j’ai lu avec intérêt et
assiduité la production de mes contemporains franco-belges
jusqu’aux années 2000, environ. Après j’ai
totalement arrêté. Pour moi, le ver dans le fruit est
arrivé avec Persepolis de Marjane
Satrapi, et ce, indépendamment des qualités
intrinsèques de la production de cet auteur. Mais lorsque
vous citez Approximativement, force m’est de constater
que, par rapport à l’autobiographie, c’est à
la parution précise de ce livre que j’ai commencé
à avoir de sérieux doutes quant à la pertinence
des projets autobiographiques à venir. Car en fait, Approximativement
signait déjà le retour d’un refoulé que
toutes les autobiographies précédentes avaient réussi
à dépasser : je parlerai de l’avènement
des singularités nues, comme en astrophysique.
 Il
me semblait que l’autobiographie était le lieu où
il était permis toutes les audaces. Comme je l’ai signalé
plus haut, il me semble qu’il y a deux manières d’envisager
la création en général : renouveler la forme
ou renouveler le contenu. Et il me semblait que pour les timides
de la forme, l’autobiographie pouvait au moins permettre de
s’enfoncer plus audacieusement dans le contenu. Il ne s’agit
pas pour moi de défendre l’idée que le déballage
le plus anarchique de nos impudeurs personnelles soit la solution.
La litanie de la « sincérité » n’est
pas non plus une justification à la parution du n’importe
quoi. Mais, au moins, il me semblait qu’à se pencher
sur soi on essaierait au moins de ne pas se voiler la face. Hélas,
je trouve qu’avec Approximativement, déjà,
il y avait le retour des schèmes traditionnels des personnages
classiques de fiction que redoublait le « masque »,
volontairement assumé par l’auteur, du personnage animalier
doublé du style « patate » (trait minimaliste).
Au bout du compte, qu’espère-t-on faire dire à
un personnage qui n’est qu’une marionnette prenant la
forme d’un perroquet ? Comment explorer la figure de l’Autre,
de Soi, de l’Autre en Soi quand on le/se dessine exactement
comme on dessine nos propres personnages de fictions ? Enfin, quelle
différence y a-t-il entre « Lewis
Trondheim/perroquet » et la figure de Lapinot ? Les
deux masques disent à peu près la même chose,
ils ont à peu près la même psychologie, ils
sont à peu près la représentation du même
sujet pensant auquel le lecteur peut « s’identifier »
de la même manière. Il
me semblait que l’autobiographie était le lieu où
il était permis toutes les audaces. Comme je l’ai signalé
plus haut, il me semble qu’il y a deux manières d’envisager
la création en général : renouveler la forme
ou renouveler le contenu. Et il me semblait que pour les timides
de la forme, l’autobiographie pouvait au moins permettre de
s’enfoncer plus audacieusement dans le contenu. Il ne s’agit
pas pour moi de défendre l’idée que le déballage
le plus anarchique de nos impudeurs personnelles soit la solution.
La litanie de la « sincérité » n’est
pas non plus une justification à la parution du n’importe
quoi. Mais, au moins, il me semblait qu’à se pencher
sur soi on essaierait au moins de ne pas se voiler la face. Hélas,
je trouve qu’avec Approximativement, déjà,
il y avait le retour des schèmes traditionnels des personnages
classiques de fiction que redoublait le « masque »,
volontairement assumé par l’auteur, du personnage animalier
doublé du style « patate » (trait minimaliste).
Au bout du compte, qu’espère-t-on faire dire à
un personnage qui n’est qu’une marionnette prenant la
forme d’un perroquet ? Comment explorer la figure de l’Autre,
de Soi, de l’Autre en Soi quand on le/se dessine exactement
comme on dessine nos propres personnages de fictions ? Enfin, quelle
différence y a-t-il entre « Lewis
Trondheim/perroquet » et la figure de Lapinot ? Les
deux masques disent à peu près la même chose,
ils ont à peu près la même psychologie, ils
sont à peu près la représentation du même
sujet pensant auquel le lecteur peut « s’identifier »
de la même manière.
Or il me semble que l’autobiographie est précisément
le seul endroit où le personnage censé être
le narrateur n’autorise pas que le lecteur s’identifie.
Au contraire. Il me semblait que l’autobiographie, avec son
« je », interdisait au lecteur de s’identifier,
l’obligeant même à regarder enfin l’Autre
comme une altérité définitive et irréductible.
Or, que voit-on désormais dans la production autobiographique
? Jamais rien d’autre que des Sujets qui jouent à enfiler
les costumes de personnages « autobiographiques » qui
ne vont plus que baguenauder dans la page pour vivre des aventures
de « réalité quotidienne ». À y
regarder de près, ou plutôt à y regarder de
loin, comme Proust disait de La Recherche
(« je ne regarde pas mes personnages au microscope mais au
télescope » ou quelque chose comme ça), tous
les « personnages autobiographiques » contemporains
obéissent aux mêmes lois : celles d’un «
genre » qui n’en était pas un au départ
et qui s’est enkysté comme tel. Lisons, regardons :
tous les personnages autobiographiques contemporains, et d’autant
plus ceux des blogs, sont identiques et interchangeables. D’abord
ils ont tous entre trente et quarante ans, ils font tous partie
de la même catégorie socio-culturelle (trentenaires
hétérosexuels blancs, petits-bourgeois ou travailleurs
précaires –ce n’est pas incompatible- obédience
politique majoritairement de gauche molle, pré ou post bobos,
etc.) et ils ont tous (c’est ça ce qui est le plus grave)
la même psyché. C’est-à-dire que leur inconscient
psychanalytique est structuré par les mêmes topoï
générationnels ; ils ont tous vu les mêmes séries
télévisées, ils ont tous accès aux mêmes
informations et par les mêmes biais, ils ont tous à
peu près le même pouvoir d’achat et ils régurgitent
tous ce qu’ils connaissent avec le même niveau de
second degré. Mais, rassurons-nous, il en va de même
des personnages de fictions des mêmes auteurs qui, mutatis
mutandis, sont interchangeables avec le « je » qu’ils
emploient quand ils se décident à gratouiller de petits
carnets.
C’est ainsi que je crois que l’autobiographie franco-belge
a commencé à péricliter dès à
partir d’Approximativement et que les fameux «
carnets » de Joann sfar en incarnent
le sommet rococo maniériste et dégénéré.
Il ne s’agit jamais, au mieux, que d’être le meilleur
reflet possible d’une pensée unique : la pensée
néo-petite-bourgeoise « informée » d’une
classe sociale moyenne. Ce ne sont ni les prolétaires de
la « France d’en bas » qui parlent, pas plus que
ne parlent les défavorisés du système, les
laissés pour compte vrais. Mais pas davantage ne parlent
les privilégiés « d’en haut » (ce
serait intéressant, du reste ; ceci étant, ces derniers
parlent brutalement avec les organes du pouvoir en place), les aristocrates,
les vrais nantis, les énarques. Toute exception ne fera que
confirmer la règle. Et ils le savent bien tous ces auteurs
endormis qui s’ennuient et tournent autour de leur nombril
bien-pensant : dès qu’apparaît un ovni venu d’une
autre classe sociale que la leur, ils le portent aux nues et le
bouffent tout cru pour l’intégrer aussi sec à
leur idéologie journalistique. Ce fut le cas pour Marjane
Satrapi, justement. Quoi de mieux pour un occidental franco-belge
qui est structuré par son européocentrisme culpabilisé,
par ses préoccupations petites-bourgeoises et dont le second
degré même est la forme ultime de son idéologie
bien-pensante qu’un « Autre » venu d’«
Ailleurs » l’acculant à cette même culpabilité
et le « sauvant » par la même occasion en continuant
à le conforter dans l’idée que ce même
second degré est sa seule rédemption ?
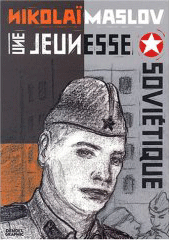 Dans
une moindre mesure, ce fut aussi le cas pour l’auteur Nikolaï
Maslov, parlant de la Russie soviétique à travers
Une jeunesse soviétique. Voilà un auteur qui
nous parlait d’ailleurs, d’une jeunesse et d’une
éducation que nous n’avons pas eues et, génialement,
c’était une autre voix qui s’exprimait, un autre
Sujet, un autre Inconscient, une autre structure psychique.
J’ai été très touché par l’ouverture
en moi d’une nouvelle boîte noire de mon propre inconscient.
Enfin je ne lisais pas ce que n’importe quel blog ou édito
journalistique pouvait me non-apprendre mais j’entendais une
autre voix, la voix d’une classe, précisément,
d’une classe sociale. Car peut-être est-ce ce
qui nous manque ici, en régime ultralibéral de la
BD indé franco-belge : une pensée de classe (dans
tous les sens du terme, d’ailleurs). Dans
une moindre mesure, ce fut aussi le cas pour l’auteur Nikolaï
Maslov, parlant de la Russie soviétique à travers
Une jeunesse soviétique. Voilà un auteur qui
nous parlait d’ailleurs, d’une jeunesse et d’une
éducation que nous n’avons pas eues et, génialement,
c’était une autre voix qui s’exprimait, un autre
Sujet, un autre Inconscient, une autre structure psychique.
J’ai été très touché par l’ouverture
en moi d’une nouvelle boîte noire de mon propre inconscient.
Enfin je ne lisais pas ce que n’importe quel blog ou édito
journalistique pouvait me non-apprendre mais j’entendais une
autre voix, la voix d’une classe, précisément,
d’une classe sociale. Car peut-être est-ce ce
qui nous manque ici, en régime ultralibéral de la
BD indé franco-belge : une pensée de classe (dans
tous les sens du terme, d’ailleurs).
J’espérais, à ma manière,
parler d’une autre voix, d’une voix de classe. Non pas
celle des « gays », dont je me fous (car les «
gays » sont intégrés, aujourd’hui, du moins
l’image bien-pensante qu’on se fait d’eux) mais celle
des gays précaires, des célibataires travailleurs
pauvres, locataires, sans véhicule, sans TV, sans portable,
sans ordinateur (ou peu s’en faut), une classe sociale inconcevable,
impensable, impensée, qui s’approche mille fois
plus de celle des lascars de banlieues (sauf que mon niveau d’études
me rend privilégié tout en m’interdisant la possibilité
de « m’unir » aux indigents dont j’ai pourtant
le peu de pouvoir d’achat et dont je partage le statut fiscal
et/ou social), de celle des ouvriers déclassés voire
des immigrés clandestins que de celle de la boboïtude
de mes camarades du Marais ou de celle des dessineux chouchoutés
de la presse – qui partagent le même arrondissement parisien.
Mais je m’égare encore, je m’égare…
Sébastien Soleille : Je trouve votre
point de vue sur Approximativement intéressant. C’est
un livre que j’apprécie beaucoup mais je veux bien admettre
qu’il a ouvert une voie qui ne s’est pas révélée
être la plus intéressante.
Sur un point au moins, à savoir le dessin,
j’aurais même tendance à renchérir sur
vous en ce qui concerne tous les suiveurs d’Approximativement.
Pour moi un des grands intérêts de l’autobiographie
en bande dessinée (ou plus généralement de
la ‘bande dessinée du quotidien’, pour reprendre
une expression de Frédéric Boilet)
est de pouvoir explorer les sentiments les plus anodins, les plus
quotidiens des individus, dans toute leur simplicité mais
également dans toute leur subtilité. À mon
sens, cela passe, plus ou moins nécessairement, par une description
fine des expressions du visage ou de certaines attitudes corporelles,
les jeux de main en particulier. Or le style ‘patate’,
pour reprendre votre expression, utilisé par Trondheim
et beaucoup d’autres ne permet pas spécialement une
telle subtilité de traitement. Un personnage de type ‘patate’
peut facilement exprimer des sentiments très tranchés
(peur, surprise, rire, colère, etc.) mais saura moins faire
passer les expressions plus subtiles de la vie de tous les jours.
De ce fait, si ce type de personnages convient bien, à mon
avis, aux Tintin et autres Spirou, personnages sans états
d’âme, tournés vers l’action et non vers
l’introspection (et s’il permet mieux, si l’on suit
Scott Mc Cloud, aux lecteurs de s’identifier
à eux), il est beaucoup moins adapté à une
bande dessinée plus proche de personnages ordinaires. En
utilisant de tels personnages ‘patate’, les auteurs se
cantonnent la plupart du temps à un jeu assez restreint d’expressions
stéréotypées…
Aujourd’hui, malgré le développement
de la ‘bande dessinée du quotidien’, peu d’auteurs
cherchent à rendre cette subtilité d’expression
(j’aurais tendance à citer Frédéric
Boilet, Taiyou Matsumoto pour
son attachement à rendre compte de certaines expressions
corporelles…).
Vous faites partie de ces auteurs, attachant
beaucoup d’importance aux expressions des visages de vos personnages,
ainsi qu’à leurs jeux de mains. Cela vous est-il venu
naturellement, à force de travailler d’après
photographie ou d’après nature ? Mettez-vous parfois
cet aspect en avant pour faire ressentir particulièrement
certains sentiments au lecteur ?
 Fabrice Neaud : Je ne sais pas si c’est
un mouvement naturel chez moi mais il est clair que votre question
touche un point fondamental dans mon travail : non seulement
j’attache beaucoup d’importance aux expressions du corps
dans le dessin (à cet égard je crois que nous pourrions
de nouveau citer l'oeuvre d’Aristophane
comme exemple de réussite exemplaire d’exploration minutieuse
des expressions du corps dans le dessin de bande dessinée)
mais je crois même que c’est devenu presque le but quasi
ultime de toute mon entreprise autobiographique, du moins le but
de mon dessin. Fabrice Neaud : Je ne sais pas si c’est
un mouvement naturel chez moi mais il est clair que votre question
touche un point fondamental dans mon travail : non seulement
j’attache beaucoup d’importance aux expressions du corps
dans le dessin (à cet égard je crois que nous pourrions
de nouveau citer l'oeuvre d’Aristophane
comme exemple de réussite exemplaire d’exploration minutieuse
des expressions du corps dans le dessin de bande dessinée)
mais je crois même que c’est devenu presque le but quasi
ultime de toute mon entreprise autobiographique, du moins le but
de mon dessin.
Il est amusant que vous évoquiez Trondheim.
Non seulement dans quelques récentes pages (non publiées
encore) j’ai essayé de construire une critique de son
« système » mais, comme c’est
un auteur que j’apprécie, je lui en ai parlé
de vive voix l’année dernière, aux Universités
d’été de la bande dessinée organisées
par le Cnbdi (aujourd’hui le Cibdi). Il est évident
que je ne remets pas du tout en cause ce qu’il a construit
lui-même dans son œuvre : c’est cohérent,
cela fonctionne. Ce qui est dérangeant, bien entendu, c’est
le « suivisme » et les suiveurs de ce système
qui, à mon sens, ne s’interrogent absolument pas sur
les outils qu’ils utilisent. Ils se contentent de piocher au
hasard dans la « boîte à outils »
de technique graphique mise au point par d’autres (Trondheim
en l’occurrence) et basta.
L’outil « bonhomme patate »
a ses limites. Ce qui est amusant, c’est que cette construction
de dessin venait, au cœur de l’expérience de la
bande dessinée alternative des années 90, comme un
des éléments de critique, de réponse et de
réaction à la bd cartonnée couleur réaliste
ou semi-réaliste des années 70/80 : le 48CC si
bien décrit par Menu. Cet élément
pourrait être comparé à la manière de
peindre de l’art roman lui-même réponse et réaction
au réalisme tardif de l’art romain et grec : les
premières images chrétiennes sont souvent assez minimalistes,
très symboliques, pour être plus proche de l’expression
de l’idée propre à l’expression d’une
foi en une transcendance que de la simple représentation
figurative du réel, en réaction même contre
elle. Je pense que le style minimaliste du « bonhomme
patate » était un des éléments de
la vaste critique du 48CC. Il est d’ailleurs éclairant
de se rappeler combien mes débuts en tant que dessinateur
« réaliste » (mais ceci reste toujours
à préciser car je crois qu’aujourd’hui aucun
des contempteurs de ce réalisme ne sait exactement ce que
celui-ci recouvre et encore moins ce que le mien dénonce…)
dans le milieu de cette « bd indé »
furent violemment critiqués, notamment par la marge la plus
radicale, à l’époque, ou qui se voulait telle,
de cette bande dessinée… Certes, le grand public, et
même le public averti, ne s’en souviendra pas ;
cela demeura une querelle interne de spécialistes stipendiés,
mais moi je m’en souviens très bien pour en garder encore
des meurtrissures non cicatrisées. Cet ostracisme fut bien
réel. Dans le mouvement critique général, je
ne faisais pas que figure d’ovni mais bien de pur et simple
réactionnaire. Nous rejoignons ici la
première question de la deuxième partie de notre entretien
et il suffit d’y renvoyer notre lecteur !... Ce qui est
amusant c’est qu’en mon for intérieur j’avais
déjà anticipé ce type de réactions,
même si je n’ai jamais su offrir de réponse critique
adéquate ou simplement audible – peut-être cet
entretien m’en donne-t-il l’opportunité, mais je
m’égare…
Bref, la ou les discussions que j’ai eue(s)
à cette occasion avec Trondheim
est/sont éclairante(s) car lui ne serait évidemment
pas du tout d’accord avec vous (ni avec moi) sur les limites
du « bonhomme patate ». Dans son ambition
un peu totalisante (je n’ai pas dit totalitaire !…)
il prétend que tout est possible avec le « bonhomme
patate », même les plus extrêmes subtilités
dont vous parlez : les mouvements du corps, les expressions
d’un visage, les infinies variations d’une lumière
sur un paysage. N’oublions pas que le « bonhomme
patate » émerge lui-même comme une dénonciation
des limites du réalisme, comme une critique fondamentale
de celui-ci. Le style réaliste ou semi-réaliste des
séries bd « 48CC » des années
80 est totalement mort et vide de sens aujourd’hui, la bande
dessinée alternative des années 90, et avec elle l’émergence,
entre autre, de ce « bonhomme patate », a
prouvé par l’exemple et par ces productions que l’on
pouvait faire les mêmes types de récits que les séries
des années 80 en mieux, en plus vivant, en plus long, en
plus rebondissant, tout simplement parce que le « bonhomme
patate » permet d’économiser du temps de
production (donc d’être plus rapide) mais, surtout, de
coller au plus près aux impératifs de vivacité
d’un récit d’aventure. Trondheim,
avec son inaugural Lapinot et les carottes de Patagonie,
a balayé définitivement d’un revers de main cette
dictature du dessin laborieux, du scénario écrit bien
proprement à l’avance et il a prouvé, finalement,
que le « rough » de départ d’une
bd était déjà une bande dessinée !
En outre il ne s’est pas suffit de ça, il a poussé
Lapinot jusqu’au bout (jusqu’à la mort de son personnage)
en explorant à peu près tous les types de récit
« d’aventure » possible avec ce personnage
pour enfoncer le clou. Enfin, il serait injuste de considérer
que le « bonhomme patate » trondheimite ne
sert que le récit « d’aventure »
autrefois chasse gardée du 48CC laborieux (et souvent réaliste
ou semi-réaliste) et lui, ou quelques autres, ont su montrer
que l’on pouvait effectivement explorer tout type de récit,
même le plus intime, nécessitant des subtilités
de narration, de dessin, des lenteurs diamétralement opposées
aux topos de « l’aventure ». Après
tout, Chris Ware n’utilise-t-il
pas le « bonhomme patate » ? Et quelle
leçon magistrale que son œuvre ! Quelle bouleversante
palette d’émotions intérieures que le sublime
Jimmy Corrigan ! Mais nous pourrions tout aussi bien
penser à Fabio, également.
J’en vois quelques autres, pas tant que ça, mais je
n’ai pas tous les noms en tête.
D’un point de vue purement théorique
je suis prêt à accorder foi à l’ambition
de Trondheim. Du reste, je vois assez
bien, dans ma tête, toutes les possibilités du « bonhomme
patate ». Enfin, cela est plus que théorique,
comme le prouvent les noms et les œuvres que je viens de citer.
Oui. On peut tout faire avec le « bonhomme patate ».
 Le
problème n’est pas tant que l’on peut tout faire
avec lui mais que la mode qui a suivi interdit carrément
de faire autre chose. Ou autrement. En outre, le fait que le « bonhomme
patate » fit partie des éléments de la
critique – pour faire large – du réalisme interdit
désormais d’explorer un dessin qui passe donc, quoi
qu’il arrive, pour réactionnaire ; et ce n’est
pas la récente nomination au festival international de la
bande dessinée d’Angoulême 2008 de
Shaun Tan (avec son réalisme photographique) qui me
contredira, ni même le travail régulier de Boilet.
Nous avons affaire là à de pures exceptions toutes
marginales. Qu’on puisse tout faire avec le « bonhomme
patate » est une chose, mais je crains que ce dernier
soit vraiment devenu une solution de facilité pour tout auteur
plus ou moins débutant. L’économie de moyens
que cette boîte à outils permet est telle qu’il
est difficile de ne pas se laisser emporter par ses sirènes. Le
problème n’est pas tant que l’on peut tout faire
avec lui mais que la mode qui a suivi interdit carrément
de faire autre chose. Ou autrement. En outre, le fait que le « bonhomme
patate » fit partie des éléments de la
critique – pour faire large – du réalisme interdit
désormais d’explorer un dessin qui passe donc, quoi
qu’il arrive, pour réactionnaire ; et ce n’est
pas la récente nomination au festival international de la
bande dessinée d’Angoulême 2008 de
Shaun Tan (avec son réalisme photographique) qui me
contredira, ni même le travail régulier de Boilet.
Nous avons affaire là à de pures exceptions toutes
marginales. Qu’on puisse tout faire avec le « bonhomme
patate » est une chose, mais je crains que ce dernier
soit vraiment devenu une solution de facilité pour tout auteur
plus ou moins débutant. L’économie de moyens
que cette boîte à outils permet est telle qu’il
est difficile de ne pas se laisser emporter par ses sirènes.
Ainsi, je ne suis pas tout à fait d’accord
avec vous lorsque vous dites que le « bonhomme patate »
ne permet que des « expressions tranchées ».
Le problème est ailleurs. Ce qui me gêne, plutôt,
c’est que l’on doive se cantonner à une seule écriture
possible dans un récit et, a fortiori, dans l’ensemble
d’une œuvre. En outre, ce que permet le réalisme,
mais là je ne fais que répéter ma réponse
à votre question au début de la deuxième partie
de notre entretien, c’est de « sauter »,
justement, vers un dessin parfois plus minimal, plus « patate ».
Le manga le prouve : personnages très schématisés,
paysages très réalistes. Scott
McCloud lui-même l’analyse fort bien dans Understanding
comics : une scène d’action fait appel à
des dessins très signalétiques, schématisant
les mouvements, mais rien n’empêche, en une case, de
focaliser sur le détail fouillé d’une musculature
en action ou bien le détail d’une pièce de vêtement,
d’une inscription très ornée sur la poignée
d’une épée… Je ne me prive pas de ce genre
de « zooms avant » dans mes récits.
Un long dialogue entre deux personnages m’interdit d’employer
un réalisme trop fouillé à chaque case, en
revanche, rien ne m’empêche de focaliser sur le visage
d’un des protagonistes lors d’une case, sur sa main, ou
sur le détail plus précis encore d’un grain de
peau… On pourrait parler de « haute définition »
et de « basse définition », en fait.
Le « bonhomme patate » étant évidemment
la « basse définition ». Je vais explorer
davantage ces changements de focale dans mes récits ultérieurs,
d’ailleurs. Et cela, pour le coup, est interdit au « bonhomme
patate » ! Son niveau de focale imposée au
lecteur est tellement « basse définition »
qu’il est impossible, sans rupture de la lecture, de faire
une focale « haute définition » au
milieu du récit. Regardez les tentatives d’Hergé
quand il fait des gros plans sur des mains ou des visages :
ça ne fonctionne pas parce qu’il a imposé à
son lecteur une « basse définition »
(bon, certes, Tintin n’est pas totalement « patate »
mais je crois que l’on comprend ce que je veux dire…)
auquel il s’habitue à un point tel que revenir à
un « réalisme » est impossible. Or
seul le réalisme, comme écriture première,
imposant sa « haute définition » d’emblée
dans l’imaginaire du lecteur, autorise par la suite une dégradation
de celle-ci ; il lui reste possible de « réduire »
un personnage à quelques signes que le lecteur aura pu observer
par ailleurs au cours du récit.
On ne peut pas « récupérer
de la netteté » d’une image très fortement
pixellisée. De la même manière, on ne peut pas
« récupérer » des détails d’un
visage réduit au smiley ! Simplement parce qu’il
n’y en a pas ! Toute l’identité du smiley
est dans le minimalisme de ces quelques traits. Toute l’identité
du « bonhomme patate » est dans sa « patatitude ».
Il n’existe pas de référent réaliste à
un personnage minimal créé d’emblée en
basse définition. Le « bonhomme patate »
fait corps avec la feuille, il est pure 2D, pur symbole, pur signe,
pure abstraction. C’est aussi pour cela qu’on prétend
à son universalité supposée. Il colle au langage.
Il colle au verbe. En ce sens, le « bonhomme patate »
est purement « cerveau gauche ». Finalement,
je pense qu’avec les concepts de « haute définition
/ basse définition », on met le doigt pour la
première fois sur la possibilité d’une critique
rationnelle du « bonhomme patate » et on renverse
enfin l’argument qui faisait de ce dernier une critique du
dessin réaliste. Reste la question de l’universalité :
certes, le minimalisme du signe, du verbe, semble être plus
« universel » que le réalisme (photographique
ou non). Mais cela interdit-il d’explorer celui-ci ? Il
existe une autre façon de dessiner. Il existe une autre façon
de faire des récits dessinés. Moins universels ?
C’est à voir… Car en quoi « l’universalité »
prétendue d’un récit (ou d’un dessin) serait
le seul critère de validité recevable de celui-ci
?
Sébastien Soleille : Ces réflexions
me font penser à un autre auteur qui aime s'attarder sur
les expressions de ses personnages et qui est un habitué
des passages de « haute définition »
à « basse définition » pour
ses portraits, un peu comme vous : Jaime Hernandez
passe souvent, presque d'une case à l'autre, d'un
style réaliste aux expressions mesurées à un
style « patate » aux expressions très
stylisées. On pourrait sûrement en citer d'autres,
même si ce n'est pas si fréquent.
Je souhaite maintenant rebondir sur votre phrase
: « Ce qui me gêne, plutôt, c’est que
l’on doive se cantonner à une seule écriture
possible dans un récit et, a fortiori, dans l’ensemble
d’une œuvre. » Le changement de style dans
un même récit, dont le « changement de focale »
pour les personnages est en quelque sorte un cas particulier, me
semble encore être une possibilité sous-exploitée.
Mais très peu d'auteurs varient leur
style de dessin pour coller aux sentiments des personnages. Cela se fait un peu en littérature (un exemple m'ayant particulièrement
frappé est Roman furieux, roman de Renaud
Camus où le style semble se déliter au fur
et à mesure de la décadence de Roman et de sa cour). En bande dessinée, cela me semble assez rare. Comme si la
sacro-sainte lisibilité chère à Hergé,
notamment, obligeait encore les auteurs à conserver un style
le plus homogène possible pour ne pas dérouter le
lecteur.
 Baudoin
a toutefois exploré cette voie avec beaucoup de succès.
On en trouve plusieurs exemples extraordinaires dans le Portrait,
aux pages 28 et 29 notamment : À deux reprises et à
peu de temps (deux heures) d'intervalle, le peintre Michel se promène
dans les rues. La tradition voudrait que les deux dessins soient
très proches, éventuellement au changement de cadrage
près. Or il n'en est rien : la première fois, Michel
est joyeux, « les rues ressemblaient à des rues
et les pigeons à des pigeons... », le dessin est
assez net, la rue semble agréable ; la deuxième fois,
Michel est déprimé, « les rues étaient
redevenues des égouts à ciel ouvert, et les pigeons
des rats volants », le trait est épais, le dessin
peu précis, la tristesse du personnage envahit complètement
le dessin. Le même album offre un autre passage où
le style évolue en quelques cases pour suivre le changement
intérieur d'un personnage : Lorsque Michel apprend que Carol
et Charles ont passé la nuit ensemble, le dessin des quatre
dernières cases de la page 29 se brouille, exprimant le trouble
extrême de Michel. Cette approche « expressionniste »
du dessin, très loin de la « lisibilité »
traditionnelle reste exceptionnelle. Baudoin
a toutefois exploré cette voie avec beaucoup de succès.
On en trouve plusieurs exemples extraordinaires dans le Portrait,
aux pages 28 et 29 notamment : À deux reprises et à
peu de temps (deux heures) d'intervalle, le peintre Michel se promène
dans les rues. La tradition voudrait que les deux dessins soient
très proches, éventuellement au changement de cadrage
près. Or il n'en est rien : la première fois, Michel
est joyeux, « les rues ressemblaient à des rues
et les pigeons à des pigeons... », le dessin est
assez net, la rue semble agréable ; la deuxième fois,
Michel est déprimé, « les rues étaient
redevenues des égouts à ciel ouvert, et les pigeons
des rats volants », le trait est épais, le dessin
peu précis, la tristesse du personnage envahit complètement
le dessin. Le même album offre un autre passage où
le style évolue en quelques cases pour suivre le changement
intérieur d'un personnage : Lorsque Michel apprend que Carol
et Charles ont passé la nuit ensemble, le dessin des quatre
dernières cases de la page 29 se brouille, exprimant le trouble
extrême de Michel. Cette approche « expressionniste »
du dessin, très loin de la « lisibilité »
traditionnelle reste exceptionnelle.
Vous jouez également sur le décor
pour 'extérioriser' les sentiments de vos personnages, mais
en le modifiant, en le remplaçant par un décor 'imaginaire'
(comme lors de la première discussion au café entre
Fabrice et Dominique, dans le volume
3, ou lors de l'explication entre les deux mêmes, avec
le décor de ville en ruines, dans le même album), plutôt
qu'en faisant évoluer votre style : que le décor soit
'réel' (la chambre de Dominique) ou 'imaginaire' (les ruines),
le style reste réaliste. Lorsque votre trait se brouille,
c'est généralement limité aux visages, qui
semblent s'effacer (un peu « à la Francis
Bacon »).
Plus généralement, vous introduisez
parfois des innovations formelles dans vos planches mais dans un
cadre apparemment classique (dessin réaliste la plupart du
temps, mise en cases régulière...). Comment voyez-vous
l'innovation formelle dans votre oeuvre ? Vous considérez-vous
comme un « timide de la forme » pour reprendre
une expression que vous avez employée un peu plus tôt
?
Fabrice Neaud : Je connais mal le travail
de Jaime Hernandez. Je connais davantage
celui de Baudoin, évidemment,
si bien que cela devient un exercice d’admiration obligé
pour moi que de lui rendre hommage. Je n’ai pas d’exemples
en tête de changement de focale ou de passage « basse
définition/haute définition » et revers
dans la bande dessinée. Je n’en ai pas sous la main
maintenant. J’ai cependant quelques exemples qui ne sont pas
tout à fait ce que j’entends par là mais qui
peuvent donner une idée : ce sont les mangas, tout simplement.
Sauf que le traitement « basse définition/haute
définition » du manga ne se fait pas sur un même
objet mais se répartit plus généralement à
des objets précis tout le long de l’ouvrage.
Par exemple, il est un trait notoire du manga que
les personnages sont beaucoup plus stylisés que les décors.
Nous arrivons parfois à des extrémités telles
(Tezuka) que les personnages ne sont
plus très loin du bonhomme patate et les décors presque
hyper réalistes. Scott McCloud
l’a développé et expliqué dans son dernier
ouvrage : il se trouve que les personnages étant des
sujets pensants, il convient, pour une meilleure adhérence
du lecteur, de les styliser. Nous nous voyons nous-mêmes,
intérieurement, comme une gamme infinie d’expressions
simplifiées, alors que nous percevons notre entourage puis
notre environnement de manière plus « objective ».
Le regard intérieur n’est pas rétinien mais mental.
Je simplifie ici à outrance le phénomène mais
je crois que notre lecteur peut comprendre ce que je veux dire et
opérer les nuances qui s’imposent.
Le comic-strip utilise parfois cette méthode.
Certains dessinateurs synthétisent les traits de leurs personnages
et demeurent plus réalistes sur les décors. Pour ma
part, je crois avoir fait l’erreur, dans mes débuts,
de ne pas trop varier mon écriture. J’ai eu tendance
à opérer la même distance (ou absence de distance)
entre mes « personnages » et mes décors…
Cela a sans doute contribué à l’impression de
froideur que mes récits dégagent encore pour certains.
J’essaie d’être (curieusement) plus « bédé »
aujourd’hui. Peut-être est-ce dû aussi à
une lente et meilleure maîtrise du dessin (même si je
me considère toujours aussi nul). Bref, j’essaie de
varier un peu plus et mieux les expressions des visages plutôt
que de rester à cette permanente asthénie faciale
sur laquelle le lecteur était censé projeter tout
ce qu’il voulait. Mais je m’égare.
 La scène du tome 3 que
vous citez obéit davantage à l’illustration d’un
état mental par la variation du décor. Le décor
change à l’arrière d’un personnage qui n’est
pas censé avoir changé de lieu. Ceci n’est donc
pas une variation de style. Quant aux variations graphiques que
je peux m’amuser à faire parfois (sur les visages),
elles sont un peu anciennes aussi… Surtout dans le tome
1. Je pense que j’essaie de limiter ce genre d’artifices
également. Cela tenait surtout à une lassitude liée
à « l’itération iconique »
de certaines scènes (la répétition quasi identique,
ou identique, d’une même case pour ne faire varier que
le contenu verbal et/ou émotionnel de la scène)…
La scène du tome 3 que
vous citez obéit davantage à l’illustration d’un
état mental par la variation du décor. Le décor
change à l’arrière d’un personnage qui n’est
pas censé avoir changé de lieu. Ceci n’est donc
pas une variation de style. Quant aux variations graphiques que
je peux m’amuser à faire parfois (sur les visages),
elles sont un peu anciennes aussi… Surtout dans le tome
1. Je pense que j’essaie de limiter ce genre d’artifices
également. Cela tenait surtout à une lassitude liée
à « l’itération iconique »
de certaines scènes (la répétition quasi identique,
ou identique, d’une même case pour ne faire varier que
le contenu verbal et/ou émotionnel de la scène)…
Ma « timidité » quant
aux innovations formelles m’a obligé à utiliser
ce type de stratégie : je joue davantage sur des illustrations
d’états mentaux que sur des variations de styles. J’espère
me sentir plus libre aujourd’hui. Mais je reste sensible à
cette histoire de variations « basse définition/haute
définition ». Dans les mangas, encore, cela se
produit sur des objets qui sont des « extensions »
du personnage (une épée, un révolver, un verre,
un stylo…). Dans l’action, l’objet fait corps avec
son propriétaire, il est une extension de son bras et, se
faisant, de sa personne, de son caractère, de son ego…
Mais il suffit que le même propriétaire s’attarde
sur l’objet en question pour qu’il s’en sépare
et qu’on observe un changement graphique, vers la « haute
définition ».
Je reviendrai à ma critique plus générale
des récits contemporains « indé » :
ils sont (presque) tous en « basse définition ».
C’est très ennuyeux.
En outre, je parlais plus haut de « l’itération
iconique ». Elle me semble être l’un des marqueurs
les plus forts (avec l’utilisation du noir et blanc) de la
« bédé indé »… Personne
d’autre mieux que Lewis Trondheim
n’a systématisé ce procédé. Hélas,
c’est devenu l’un des plus pénible poncifs de toute
la « bédé indé ». En
gros, nombres de jeunes auteurs qui veulent faire intelligent utilisent
ce procédé… Comme je le disais en autocritique
plus haut, j’ai utilisé (et j’utilise encore) ce
procédé facile pour « faire intelligent ».
Facile parce qu’on ne se foule pas. Il suffit, au mieux, de
répéter la même case (ça fait l’économie
de l’imagination et avec une bonne photocopieuse…) et
de changer le contenu des phylactères, de générer
des silences (ça fait toujours sens) et le tour est joué.
C’est le frottement entre l’absence de changement visuel
et celui du contenu textuel qui provoque des dissonances et permet
une grande gamme de variations émotionnelles… Certes,
ce minimalisme narratif a permis de s’inscrire en faux contre
toute la « bédé mainstream »
qui, craignant comme la peste l’ennui du lecteur, ne cessait
de varier les points de vue, les cadrages, les focales, jusqu’à
la nausée. Mais bon. Il faut avouer que le procédé
de l’itération iconique, lorsqu’il est adjoint
au style patate, qu’on s’amuse de surcroît à
inscrire tout ça dans un joli gaufrier régulier et
systématique le long de tout un album, à force, ça
confine à la fumisterie caractérisée sans compter
que c’est d’une suffisance intellectuelle sans bornes.
De temps en temps, quand c’est vraiment utile, et quand surtout,
on souhaite réserver son artillerie graphique lourde pour
d’autres scènes, d’accord, mais tout le long d’un
livre, pfiou, c’est fatigant. Le pauvre Lewis
en est-il responsable ? Non, bien entendu. Mais je crois que
tout l’OuBaPo devrait faire pénitence pour avoir donné
cette vilaine idée à tant d’imbéciles,
ha, ha.
Suite de la discussion ... ...
Cette discussion a eu lieu par e-mail entre le 13
décembre 2007 et le 25 avril 2008.
Toutes les images sont © Fabrice
Neaud et les éditeurs (Ego comme X) ainsi que Panini Comics,
Cornélius, Denoël Graphic, Dargaud et l'Association
|